Le cadre d'une photo c'est quatre segments de droite horizontaux et verticaux articulés à angle droit. Ou bien, ce qui n'est pas la même chose, c'est quatre angles droits joints par quatre segments de droite horizontaux et verticaux. Le phénomène est bidimensionnel, et très mince, car étant donné la matière de la photographie ces angles et droites sont seulement le lieu impalpable d'une cessation, celle des empreintes photoniques. Le cadrage est la relation active ou passive de cette cessation aux empreintes qui s'y achèvent.
Il y a encore en photographie un autre cadre, ou un autre cadrage, avec des propriétés étranges : celui du viseur, reflex ou non. Il est le commencement d'une béance, ou le bord d'une intrusion. Lui aussi mince et impalpablement bidimensionnel.
Enfin, en raison de sa multiplication et de ses retirages indéfinis, le processus photographique introduit un cadre de recadrage et de feuillètement, au moins aussi perturbateur pour l'humanisme ancien que les deux premiers. Le phénomène est mal rendu par le « en » et le « mettre » de « mise en pages », puisqu'il s'agit précisément de dépasser, déborder perceptivement le cadre de la page. Le « out » et le « lay » de « layout » sont plus heureux à cet égard, et nous adopterons ce dernier terme.
Ces trois cadres-décadrés s'adressent en nous à des couches évolutives allant de notre animalité archaïque à notre humanité primitive et à notre humanité contemporaine. Nous y retiendrons surtout l'angularité, l'horizontalité-verticalité, la bidimension tridimensionnante, la clôture comme fin d'empreinte et comme commencement de béance ou bord d'intrusion. Et nous ne serons pas étonnés que des différences d'âge et de niveau anthropologiques aient provoqué certains choix, résistances, explorations que montre l'histoire des photographes.
1. L'ANGULARITÉ
L'angle vient de loin. Il joue déjà un rôle décisif dans la vision de la grenouille, du chat, du singe. Au sein de son environnement, l'animal repère des traits qui forment avec son organisme un circuit d'afférences perceptives et d'efférences motrices susceptibles de l'y maintenir et de l'y reproduire. Ces traits sont des odeurs, des sons, des phéromones, mais aussi, quand les actions et réactions doivent être rapides, des angles, à la fois vite enregistrables et suscitant des réponses précises. L'angularité est décisive pour le chasseur qu'est l'homme quand il poursuit un gibier, cueille des fruits ou feuilleté les photos d'un magazine. Quatre angles peuvent le mettre littéralement en arrêt.
Surtout s'il s'agit d'angles droits posés horizontalement et verticalement. Ceux-ci, déjà actifs dans la vision du chat, prennent toute leur force chez le bipède terrestre. Les autres bipèdes sont des volatiles, ils n'ont pas à avoir ce dressement actif sur le sol que les langues romanes appellent joliment la stature. La stature n'est pas seulement l'érection contre la pesanteur terrestre que l'arbre réalise de façon enracinée et immobile, c'est l'exercice mobile et militant de l'équilibre vertical sur la surface minime de deux plantes de pied, moyennant d'innombrables feedbacks. C'est il y a un bon million d'années qu'a commencé à se mettre en place ce rapport stature/ horizon (fig. 1), impliquant l'angle droit vertical-horizontal comme la rencontre de deux axes de référence, sources en même temps des symétries les plus simples et les plus complexes, comme l'étrange symétrie bilatérale. Ce précadrage au sol s'est complété évolutivement par un autre, qui le renverse dans la hauteur : celui de l'équerre anatomique de l'arcade sourcilière et du nez, monoculaire (fig. 2), et binoculaire (fig. 3). Les quatre angles droits d'un cadre nous concernent littéralement à chacun de nos pas.
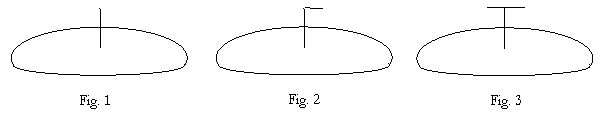 |
On comprend alors que pour la vision de l'animal debout, qui devait être à la fois articulante et compréhensive, la rétine sélectionnée ait été sensible aux ondes électromagnétiques les plus répandues sur notre planète, c'est-à-dire celles avoisinant 500 nanomètres, dominantes à partir d'un soleil de 5 800 degrés en surface. Qu'ait été sélectionnée aussi une sensibilité rétinienne largement périphérique en même temps que fovéale. Enfin, qu'aient été sélectionnées des décisions optiques n'ayant plus lieu au niveau de l'Œil, comme chez la grenouille, où sont induites des réactions réflexes, mais bien dans les foyers cérébraux profonds, permettant ainsi une interprétation disponible du donné. C'est chez l'homme qu'on peut enregistrer le plus clairement un feature ring (Noton et Stark, 1971), une circulation de l'Œil de trait en trait, mémorisée d'une part (se reproduisant assez pour une même situation et un même individu), ouverte d'autre part (non identique selon les individus et les situations). C'est chez l'homme aussi qu'on peut montrer que des trajets optiques sur un donné ne supposent pas forcément un trajet de l'Œil ; le travail des centres profonds sur le donné rétinien périphérique y suffit. Remarquable convergence : la station debout privilégie la disponibilité visuelle et l'interprétation optique retardée, et en retour cette disponibilité et cette interprétation présupposent, pour rester compréhensives, les angularités de référence de la station debout. Dès ici on peut définir l'homme comme l'animal cadreur.
L'index de base (fig. 4) qu'adopté Spencer Brown est très significatif, dans sa logique des indications. On y retrouve le cadrage ouvert haut, que nous venons de relever. Mais il est tourné droite gauche. Cela se comprend. La plupart des êtres humains sont droitiers ; la plupart ont un hémisphère droit (commandant les organes gauches) plus analogisant, et un hémisphère gauche (commandant les organes droits) plus digitalisant. Ces deux latéralisations se recouvrent, si l'on admet que la plupart des opérations humaines vont de l'analogique, approchant, au digital, conclusif. Pour rendre l'implication : indication > distinction > séparation, l'index initial de la logique ne saurait donc être ouvert de gauche à droite (fig. 5) ; il doit être l'arrêt d'un mouvement de gauche à droite butant sur un index orienté de droite à gauche (fig. 4). Ainsi, optiquement et logiquement, l'angle droit haut de droite est le plus prégnant, le haut étant plus prégnant que le bas, et la droite que la gauche ; et c'est une belle occasion de vérifier que ce qu'on appelle la prégnance d'une forme (ici « the form of distinction ») se mesure à la digitalisabilité de son analogie.
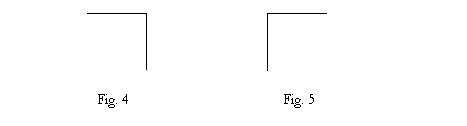 |
Cependant, tout ceci doit se nuancer du fait que la latéralisation cérébrale humaine est très souple. Elle apparaît comme un accomplissement labile au faîte d'un règne animal qui latéralisé peu (sauf chez quelques oiseaux chanteurs). D'autre part, la démarche technicienne, qui l'a sélectionnée, est elle-même possibilisatrice, nous y revenons dans un instant, et donc toujours déplaçable. Il n'y a pas à s'étonner qu'il y ait des gauchers et des ambidextres, selon les dosages les plus surprenants. Léonard de Vinci a exploité les « perversions » de la latéralité tant dans ses images produites que dans ses stratégies de production d'images.
2. LA BIDIMENSIONNALITÉ POSSIBILISATRICE
Dans le cadre, les saisies orthogonales vont de pair avec ce qu'on peut appeler la bidimensionnalité tridimensionnante, entendue comme la construction d'une profondeur à partir de données bidimensionnelles mouvantes. Cette conversion perceptivo-motrice est sans doute là depuis que les poissons, puis les premiers tétrapodes ont cessé de se distribuer multipolairement, comme les radiolaires, pour adopter un modèle longiforme, avec un vrai avant, déclenchant ainsi un sens, le sens premier qui nous habite encore toujours, le sens frontal. Dès ce moment, les cinq substitutions mobiles qui font la vie animale (et donc encore les grands thèmes de la photographie) - l'ingestion, le combat, l'accouplement, la nidification (l'habitation), l'éducation passive et active - se sont opérées à l'intérieur d'un mimétisme frontal, où toute variation même bidimensionnelle est exploitée pour organiser la profondeur indispensable aux conversions d'afférences perceptives en efférences motrices. Les mutilations d'organes montrent bien cette activité cérébrale. Assurément, les animaux qui disposent de paires d'yeux, de pattes, de narines, d'oreilles, d'antennes, utilisent leur bilatéralité pour construire un environnement stéréo-perceptif et stéréo-moteur, mais en cas de perte d'un organe de la paire, nous voyons que leur cerveau compense vite et relativement bien. Chez l'animal cadreur, chasseur à distance et à vue compréhensive, la bidimensionnalité tridimensionnante n'est plus une suppléance, c'est un instrument de base permanent. Par la station debout, nos deux mains à pouce opposé, libérées des prestations de la quadrupédie, sont devenues des mains planes à douze dimensions (trois translations et trois rotations pour chacune), extraordinaire instrument d'étalonnage, transformant l'environnement en des panoplies de substituts comparés, comparables, et par là possibilisés, indiciels, ce qui, moyennant la sélection évolutive d'un néo-cortex capable d'être « tracé » par les chevauchements de ces possibles et de ces indices, moyennant aussi un larynx leur donnant des substituts vocaux également possibilisés, fait l'essentiel de la technique, comme aussi de l'arithmétique et de la géométrie. La stature et ses angles droits verticaux à bout de bras tendus déterminent maintenant un plan perpendiculaire au sens frontal, un plan transversal (fig. 6), induisant un mimétisme transversal, où on remarquera que l'horizon (x) est lettré antérieurement à la verticale (y), bien qu'il ait besoin d'elle pour se dévoiler comme tel (l'horizontalité est la « conséquence préalable » de la verticalité). Mais, étant donné la force archaïque du sens frontal, il suffira d'inscrire une bissectrice (fig. 7) pour que le trait intermédiaire soit vu partant vers l'arrière-plan (d'ordinaire) ou vers l'avant-plan (plus rarement), selon une option qui engendre les formes dites réversibles. Pour comprendre ce qu'est la perception d'une image à deux dimensions, on remarquera qu'il ne s'agit pas ici de signes à référents déterminés mais d'indices ou d'index (fig. 8), inscrivant des directions, ordinalités et dimensions sans référents déterminés. La mathématique, qui joue là ses points de départ, est une écriture d'index, non de signes. Les angles droits transversaux mettent en arrêt l'homme technicien après l'homme chasseur.
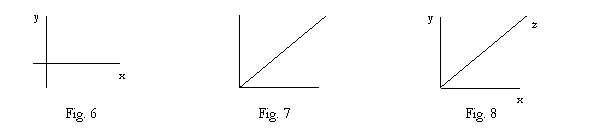 |
3. LA CLÔTURE
II a suffi alors du passage des céréales sauvages aux céréales cultivées, avec le besoin agraire de délimitation des étendues et des capacités, pour que les équerres de références (fig. 9) se ferment en rectangle (fig. 10). Rectangle au sol de la demeure et du temple, rectangle dressé de la porte à linteau. Nos langues marquent encore bien les deux aspects de la chose. La tradition latine, plus visuelle, est sensible au quatre, carré, cadre. La tradition anglo-saxonne, plus manipulatoire, remarque surtout le bâti par excellence, l'ossature, le squelette, frame (de framen, construire). Cadre de référence, frame of reference.
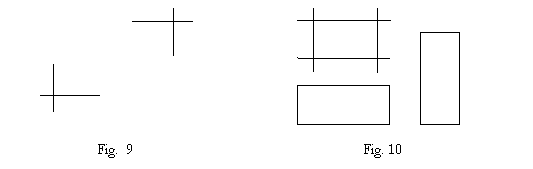 |
Du même coup, le scribe et le mandarin, chargés d'enregistrer les arpents et les boisseaux, conçurent des caractères eux-mêmes cadrés et disposés en cadres (en contre-épreuve, l'Islam nomade produisit une écriture chevauchante et ponctuée). A ses côtés, l'imagier trouva dans ces quatre angles et côtés conclusifs le lieu de la représentation. Cadré, l'environnement protéiforme devint en Occident le cosmos-mundus, les événements se contractèrent dans l'Etre, et les hommes dans l'Anthropos. Déjà l'architecte égyptien comprit que le rapport de l'Œil unitaire au cadre était la pyramide, articulant le carré et le triangle (fig. 11). La perspective occidentale fit virer cette transcendance verticale à l'immanence horizontale, où s'équivalaient A et A' (fig. 12). Vinci conclut pertinemment que le regard du cadre tridimensionnel dûment triangulé est celui de l'Homme-Dieu. Nous pouvons chanter l'hymne agricole :
Quatre droites, quatre droits
Quatre fois deux index
Mais
qui par leurs symétries ne sont pas huit mais quatre, mais deux, mais un,
chacun le même autre, l'autre même
Abolisant le reste autour
en indexant unitairement le dedans
Plan triangulant la profondeur ainsi creusée en
restant étalée
Au-delà équivalant à l'en
deçà
Totalisés dans l'inépaisseur
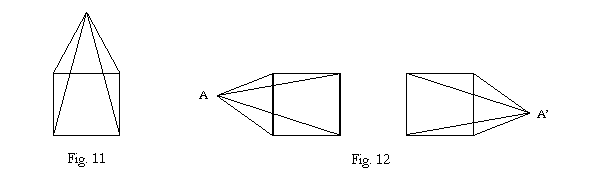 |
Certains jubilaient. Bossuet, dont Chateaubriand s'exclame : « Quelle revue il fait de la Terre ! », répète et varie : cadrer à, cadrer avec, cadrer (absolument). Les Chinois et Valéry convergent : la prise en main (frame) et la prise en Œil (cadre), donc l'homme et la terre, c'est le ca(d)ré ; tandis que le divin et le ciel c'est le rond (« le ciel immense et rond», de Baudelaire), l'indéfini, justement sans angle droit, ni même angle du tout. Entre-temps, les rouleaux, étaient devenus des codices, c'est-à-dire des cadres reliés où l'on pouvait confronter instantanément le cadre 78 avec les autres cadres 156, 22, 87, ce qui, après les poèmes et les dialogues philosophiques, donna les systèmes philosophiques : le manuel aristotélicien, la dissertation plotinienne, la somme médiévale, le discours cartésien, la logique hégélienne thétique, antithétique, synthétique.
Le cadre agricole fut si décisif, décisoire, plus important que ce qu'il limitait, qu'on l'objectalisa, et souvent en ressaut. On parla de cadres (donc de carrés) pour des bords ovales, ce qui avait encore un sens, mais même pour des bords en cercle. On résida dans de beaux cadres, avant de confondre un jour voyage et cadrage. Pour le peintre le format du cadre devait jouer un peu le rôle du module pour l'architecte, de la forme musicale (AA', AB, ABà, ABACA, etc.) pour le musicien. Selon les cultures, il y eut des cadres non dialectiques, comme le tatami japonais, qui est un double carré (fig. 13), et des cadres dialectiques, où le côté le plus grand est au plus petit comme la somme des deux est au plus grand, comme dans le nombre d'or occidental 1,618/1 (fig. 14).
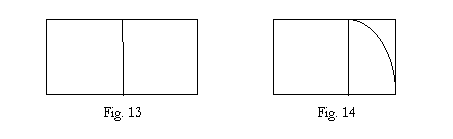 |
La photographie s'est inscrite dans cet enthousiasme, et même elle en dérive. Quand, après quelques millénaires, la volonté représentative des agriculteurs occidentaux devenus industriels les poussa à chercher des images photoniques et à découvrir les propriétés photosensibles des halogénures d'argent, il fut tout normal de donner aux empreintes ainsi obtenues la rectangularité indexatrice qui avait si puissamment prévalu dans les images sémiotiques (peintures et sculptures) produites jusque-là. Pas de contre-indication : le rectangle rendait aisé de découper, calibrer, stocker les plaques ; et, sur les films, une suite de rectangles permettait d'obtenir le maximum d'information sur le minimum de support. Il y avait même une indication importante : l'image photographique était seulement indicielle, non sémiotique, et d'autre part sa perspective demeurait fort flottante ; la faire se terminer à quatre angles droits reliés par quatre droites n'était donc pas inutile pour arrimer, baliser, en un mot indexer ce vague, et en particulier pour faire en sorte que la pyramide de l'Œil (fig. 15) aide à construire quelque peu sa pyramide symétrique, du moins en pointillé (fig. 16).
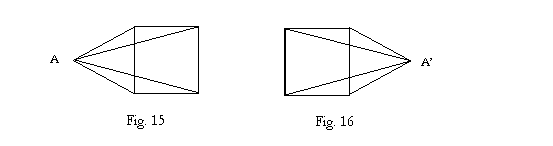 |
4. CADREUR D'EMPREINTES ET DE VISÉE (fig. 17)
Cependant, si la rectangularité des photos avait cinq ou six mille ans de tradition visuelle et proprioceptive, si la référence à l'angle droit vertical s'était mise en branle il y a un million d'années, le processus photographique introduisait une situation fort neuve déjà du fait que s'y distinguent d'ordinaire un cadre d'empreinte et un cadre de visée.
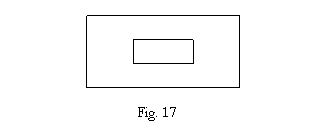 |
Certains, traditionnels en cela, cherchèrent l'empreinte. Alors, le passage par le viseur les contraignit à définir, selon le mot de Minor White, une pédagogie de la prévisualisation, laquelle consiste à anticiper cérébralement dans le cadre de visée le cadre empreint. C'est si bien ce dernier qui importe pour Ansel Adams que le terme de visualisation, sans « pré », lui paraît suffire ; à ses yeux il n'y a pas d'autre vision photographique que celle-là. Dans ce parti, le photographe est en même temps un théoricien prodiguant une pédagogie qui va jusqu'aux conseils de conservation des épreuves. Réalisme et conservatisme propres au cadre agricole ? Chez certains fétichistes assurément. Mais Adams et White savent bien que ce qu'ils enregistrent de la sorte est photonique, et donc plus cosmologique qu'agricole. Cela nous sera confirmé dans un moment par leur conception indicielle, non indexante, du cadre empreint.
En tout cas, d'autres furent fascinés par le cadre de visée, dont l'étonnement leur sembla digne d'être cultivé presque pour lui-même. Là tout s'annule, tout est nuit, comme dans la chambre noire, sauf un rectangle de photons, saisis en vision monoculaire, bidimensionnalisés, en tout cas reliés à rien. Le miracle, la merveille de cette béance-irruption, c'est que son plus petit mouvement en change le contenu, de façon presque toujours discontinue, et à tous les égards. La puissance d'indexation et de structuration des quatre angles droits et des quatre droites, là où la béance commence, là où l'irruption finit, est telle que le moindre déplacement (dont on soulignera qu'il est un déplacement absolu, délié, et pas « sur » l'objet) y déplace tout : convections spatio-temporelles, effets de champ, et par conséquent aussi lumières, événements, personnages en perpétuelles et abruptes métamorphoses. Quel suspens pour l'animal cadreur, chez qui toutes les couches d'afférences et efférences optiques sont ainsi captivées, depuis les plus archaïques, dans le croisement de l'épiphanie incessante et de la disponibilité souveraine !
Alors, pourquoi déclencher ? Parce que le déclic de l'obturateur, en faisant que la béance du viseur soit remplacée par celle de la fenêtre d'admission, vient choisir, approprier, élire une des épiphanies aperçues ; la vue se confirme en prise de vue. Et pourquoi encore développer, tirer, etc. ? Tantôt il s'agit d'une suite appelée par le métier ; on est par exemple reporter comme Cartier-Bresson, dont l'intention de visée reste pourtant déclarée : le « moment décisif » concerne le contenu de l'empreinte future, mais avant tout la prise, comparée à un « tir » déclenché par « notre grand doigt masturbateur d'obturateurs » ; il suit qu'on ne recadre pas ; amateur, on tient la technique en piètre estime, et on se défie de la théorie. Tantôt, chez Walker Evans, le cadre empreint joue comme réminiscence du cadre de prise de vue ; non pas son simple stockage, mais sa remémoration magnifiante, où il ressuscite avec ses circonstances ; au négatif élu la planche contact revisitée ajoute les chevauchements proustiens de la mémoire orchestrante ; la narration écrite accompagne volontiers la narration imagétique ; la théorie, ou plutôt le manifeste (tel le « manifeste photobiographique » qui introduit Y Eté dernier de Mora et Nori) insiste sur l'acte photographique, renvoyant à un projet plus ou moins global d'existence, dont le produit est appelé Œuvre. Dans tous ces cas, la conduite est psychosociale ou existentielle.
5. CADREURS DE DÉPART (INDEX) ET DE CESSATION (INDICE) (fig. 18)
Mais, indépendamment du cadre de visée, la photographie introduisait déjà une situation nouvelle comme cadre empreint. En effet, si ce dernier n'est pas une simple béance comme le cadre de visée ; si, comme n'importe quel cadre, il cerne un certain plein, celui de la surface photosensibilisée contrastant avec la surface vierge du tirage ; si, toujours traditionnellement, il agit sur tout ce qui se trouve dans ses limites orthogonales ; cependant il a en propre d'être de soi une cessation physique d'une empreinte physique, non l'extrémité d'une construction sémiotique. A nouveau cela donna lieu à deux attitudes qui sont encore présentes.
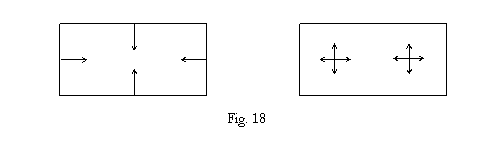 |
Les uns, en dépit de la légèreté et de l'accidentalité du cadre physique de la photo, exploitèrent sa quadrangularité, et littéralement y prirent appui. Indexateur, le rectangle fait alors partie du sujet photographique (qu'on ne confondra pas avec les thèmes) du photographe. Cartier-Bresson est exemplaire à cet égard, et le numéro que viennent de lui consacrer Les Cahiers de la photographie est d'autant plus démonstratif qu'il s'agit de quelqu'un qui est à la fois photographe et peintre, et qu'on peut ainsi vérifier que le sujet plastique d'un individu, son fantasme optique-tactile fondamental, se retrouve dans tout ce qu'il fait. Ici, cela tient en cinq ou six caractéristiques interagissantes. 1. Une irruption de convexités (parfois de vrais cylindres), généralement deux, une dominante, une dominée. 2. Une forte convection verticale, où l'on ne peut nier le mouvement de bas en haut, mais où prévaut en fin de compte le mouvement de haut en bas ; cet éboulement plastique combiné avec les convexités doubles compense la fuite de la perspective et la redresse dans le plan, en tableau (cela finit par vous tomber dessus). 3. La montée-descente s'opère en zigzags fortement décochés, presque en éclairs ; lorsque le thème est horizontal, ces décochements redressent la composition en hauteur, comme dans le portrait de Steinberg, qu'on rapprochera du Laocoon de Greco, où la verticalisation est semblable. 4. Le bruit optique est au maximum récupéré en information optique, et cela en particulier par la lumière, assez marquée pour récapituler à elle seule les trois caractères précédents ; pour ce faire, cette lumière est luminance plutôt que teinte, et le peintre est surtout dessinateur. 5. Le cadre-cadrage est alors requis comme référence de ces relations, il est leur départ ; c'est à partir de lui qu'on «tire», qu'on «dessine», à telle enseigne qu'il se renforce en un cerne noir (trait indexateur tout différent d'esprit des bords de pellicule d'Avedon, déclarativement indiciels) ; H.C.B. cadre-encadré. L'autoportrait de l'artiste-reporter mis en couverture résume pleinement ces options. Et du sujet plastique, du fantasme fondamental, se déduisent comme toujours les épiphénomènes : les thèmes choisis et leur humeur, c'est-à-dire le réalisme, l'humour, l'amertume, le classicisme, etc. C'est bien l'esthétique traditionnelle des arts de l'espace, avec leurs effets de champ significatifs, sinon qu'en peinture on prend son temps et qu'en photographie ça se passe pour finir en une fraction de seconde.
La conduite d'Ansel Adams à Yosemite est presque inverse. Dans l'empreinte photonique il faut bien qu'il y ait un cadre, mais on cherche cette fois à ce qu'il n'excède pas son caractère de simple cessation physique, non sémiotique. On ne part pas de lui, on ne tire pas à partir de lui, on y reçoit, on laisse être, on trappe. Ce qui sera empreint c'est l'accident lumineux, des millions d'accidents lumineux, antérieurs à toute entreprise sociale ou psychologique, déroutant toute identification et affleurant pour autant de l'origine. L'organisation n'est pas la décision, le punctum quelconque, mais la distribution la plus complète et la plus impartiale de la lumière, des lumières, c'est-à-dire le zone System, technique de l'épiphanie. La réalité se bouleverse de réel. La cessation quadrangulaire, puisqu'il faut bien qu'il y en ait une, on la fait intervenir là où, si on l'aperçoit, elle donne le plus à sentir qu'elle pourrait n'être pas là où elle est, que son déplacement ne changerait rien, qu'en elle il y a mille autres cessations possibles, que tout accident lumineux définit déjà de soi un cadre, qui n'est pas celui du cadrage. Sans doute cela s'opère idéalement à Yosemite, parce que la lumière franche y est lointaine (lumière de sommets) et que la lumière proche est filtrée. Mais cela peut se produire ailleurs : dans une scène de ville pour Stieglitz, sur le corps ou le visage de Marilyn pour Bert Stern. Et, indépendamment des thèmes, il y a place pour des sujets photographiques différents. La cosmologie n'est pas monotone : solidité chez Adams, porosité chez Stieglitz, dissémination chez Stern, etc.
6. CADREURS DE MISE EN PAGE ET DE LAYOUT (fig. 19)
Enfin, le processus photographique a introduit un dernier cadrage aussi perturbateur pour le cadre agricole : le cadre multipliable et recadrable jusqu'au pêle-mêle. Cela encore a donné lieu à deux attitudes. Dans ses narrations simultanées, Duane Michals profite de cette disponibilité pour concevoir des ensembles de photos s'entrecadrant en un tout fermé. Apothéose de l'index : les spectacles montés sont des « figures » au sens biblique, donc des monstrations d'index très archaïques (la station assise, la déambulation dans un couloir, rallongement sur un lit, le dressement devant un lit, etc.) que chaque photo réindexe de rectangularité avant d'être réindexée dans la page globale. Face à ce dernier avatar de la mise en pages (Duane Michals reste écrivain), The Last Sitting de Bert Stern est l'apothéose du layout comme débordement. Le bord d'une page de magazine, si page (pangere, fixer) il y a encore, n'est plus une clôture, comme celui du codex ancien, c'est le détour de la page, du feuillet suivant : l'empreinte photonique, au lieu d'y prendre place, s'ouvre avec lui. La photogénie de Marilyn c'est une transparence et une granulation de peau très compatible avec le grain photographique, mais c'est aussi un corps qui glisse et s'ourle comme un détour de page, un corps feuilletable. Le feuillètement est une des actions les moins insignifiantes qui soient : il concorde intimement avec l'horizontalité de perception par quoi le monde contemporain se différencie le plus du monde classique, vertical comme la tragédie où il culminait.
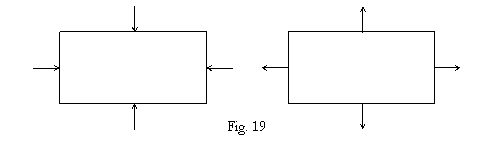 |
Ainsi nous venons d'articuler un peu durement trois approches : cadre empreint et cadre de visée, cadre index et cadre indice, cadre de mise en pages et cadre de layout. Les Images oj War de Robert Capa suffisent à prévenir que ce sont là des pôles entre lesquels il y a bien des latitudes. Mais l'ébranlement anthropologique, conscient ou inconscient, accepté ou refusé, est à peu près partout le même. Parti d'« el paese », des histoires et de « natura naturata », le cadre photographique, même quand il continue les Angélus de Milet, vire bon gré mal gré à l'univers, à la cosmologie et à « natura naturans » dans ses terribles jeux.
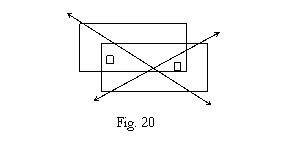 |
Remarquons bien d'abord que, depuis ses origines, notre espèce n'a guère eu affaire qu'à la lumière réfléchie, ou traversante comme dans le vitrail ; les seules lumières émises étaient celles du soleil et du feu, qui en tirèrent leur statut divin ; la photo, la BD, le cinéma ne font pas exception ; leurs images sont vues par réflexion. Or l'image TV tient en une lumière émise, où le spectacle est énergie avant d'être information. Il y aurait même là de quoi volatiliser toute information si cette lumière n'était pas froide quant à la température de la luminescence, quant à la décomposition industrielle des couleurs, quant à la ponctualité des luminophores. Ainsi, plus énergétique que n'importe quelle autre image, l'image TV demeure quand même informationnelle. Le cadre TV a évidemment le même statut. Du fait qu'il y a écran, « petit écran », il reste indexateur, informateur, mais en même temps il est dissous par l'irradiation débordante, par l'incrustation, par la superposition. La boucle de l'information-énergie télévisuelle est mise en place : (a) l'image en lumière émise est énergétique ; (b) cette .énergie, étant froide, porte assez l'information ; (c) cette information est sans cesse reconduite à son énergie par son décadre. Ainsi les multicadres du TF 1 20 heures énergétisent plus la présence du présentateur qu'ils ne renseignent sur des événements concomitants. Comme dans les clips vidéo, qui sont de la même texture. Amorcé par la photographie, le glissement du cadre agricole au multicadrage cosmologique et cosmogonique est ici confirmé.
On constate assez l'influence de cette fluorescence, de ce glossy (glowing) télévisuel dans la peinture post-moderne, depuis que la transavant-garde italienne rivalise, sur le terrain de la lumière réfléchie picturale, avec le cadre irradié. Devant la même éruption de volcan (rien n'est plus consanguin à la lumière émise froide de la TV qu'une éruption de volcan), là photographie, surtout depuis qu'elle est suppléée dans ses prestigieuses performances astronomiques par de nouveaux procédés comme le CCD, n'a guère que trois voies. Continuer de cultiver l'originalité de son cadre de visée, en s'aidant de quelque littérature. Lutter directement avec l'image et le cadre TV en irradiant, incrustant, surimprimant son cadre empreint par le recours des filtres et du dye transfer au sens large du terme. Pousser à leurs limites ses spécificités décadrantes ou multicadrantes, selon par exemple les approches de Radisic : affouillements dermiques (les couples), rutilance topologique (le noir Lucky), précadre anatomique (la cambodgienne Marilou). Et puisqu'il est question de cadre, notons que le large noir qui cerne pertinemment Marilou dans le numéro 4 de Caméra International n'est plus le trait noir d'où « tire » Cartier-Bresson mais bien le noir de la chambre noire où a lieu la stupeur cosmologique de l'irruption-béance.
Pour apprécier les enjeux, il n'est pas inutile de souligner que, parmi les civilisations planétaires, seul l'Occident a pris le cadre agricole pleinement au sérieux. C'est pourquoi il a opéré le passage de l'artisanat archaïque à l'artisanat rationnel, lequel a régné de Salamine à hier. C'est pourquoi aussi il a assimilé la présence à une « conscience », con-scire, savoir-en-rassemblant. Le multidécadre des médias contemporains redistribue les cartes. En même temps qu'il désaffecte l'artisanat ancien, il propose de remplacer la coupure monde/« conscience » par une coupure philosophique plus générale : fonctionnements/présences. Cela fait un autre être humain.
Henri Van Lier
in Les Cahiers de la Photographie, n°19, 1986