Cette étude était initialement titrée : Le Nouvel Age, Technique, Science, Art, Ethique, 1962. Le titre actuel vise à mieux marquer le rôle omniprésent et préalable de la Technique dans la phylogenèse humaine. La traduction anglaise sera retitrée de même : Priority of Technique (The New Age, 1962).
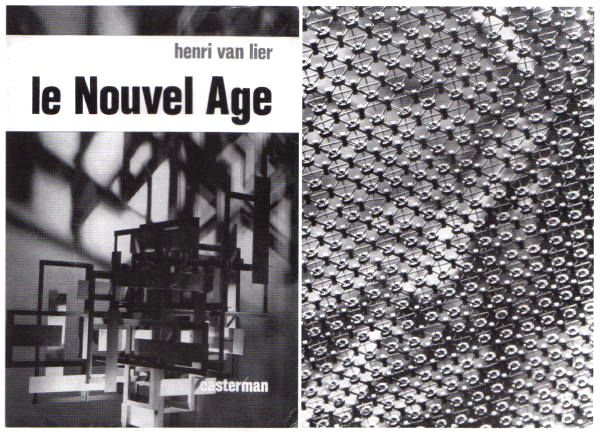
Paru dans : The International Society for Metaphysics. Studies in Methaphysics, volume I, Person and Nature.
INTRODUCTION
A. Omniprésence de la technique
On ne peut douter en effet qu’Homo, qui se distingue de tous les autres vivants par ses articulations anguleuses et angularisantes, et par ses mains planes en symétrie bilatérale, soit d’instant en instant un technicien. Dans la phylogenèse, Homo erectus a développé des techniques un million d’années avant de pratiquer des langages un peu détaillés. Dans son ontogenèse, chaque spécimen hominien baigne dans un environnement technicien dès le berceau ou les bras de ses géniteurs. Nos langages n’ont de significations que dans la mesure où ils sont des thématisations phoniques ou écrites d’un milieu technique préalable ; pour l’avoir oublié, les linguistiques « classiques », de Saussure à Chomsky, ont bien décrit quelques propriétés formelles des langues, mais sans pouvoir comprendre qu’il signifie. Pour Homo, même la « nature » est technicisée. Ses forêt traversées de chemins. Ses animaux chassés ou élevés rituellement.
On a d’ordinaire remarqué que les techniques angularisantes prolongent le corps anguleux d’Homo, et augmentent ainsi ses pouvoirs, parfois démesurément. Mais il y a plus essentiel. Pour chaque peuple, les techniques instaurent et soutiennent ses espaces et ses temps propres, donc sa topologie, sa cybernétique, sa logico-sémiotique, sa présentivité, - ce qu’on appelle sa culture ou sa civilisation. L’absence de la roue conforta les cultures constrictives et sans futur des Amérindiens. Inversement, leur saisie constrictive et sans futur leur dicta de ne pas développer la roue.
La technique est si première et si dernière chez Homo qu’il conçoit d’ordinaire l’Univers entier comme un objet technique, auquel il prête donc un Technicien maître : des dieux, un démiurge unique, des flux généraux, ou encore un grand Axiome. Au point qu’on peut se demander si beaucoup des problèmes métaphysiques d’Homo ne viennent pas de ce qu’il est incapable de concevoir quoi que ce soit sinon comme un objet technique, alors que l’Univers, qui cependant l’a produit comme technicien, n’est pas un objet technique, mais justement un objet naturel. Creare, faire croître, est l’actif de crescere, croître. Homo technicien a compris plus vite creare que crescere.
B. Absence de théories de la technique
Si la technique est si essentielle à Homo, on aurait pu attendre qu’elle suscite des philosophies multiples et riches. Or, il n’en fut rien. Ni Platon, ni Plotin, ni Thomas d’Aquin, ni Descartes, ni Kant, ni Hegel, même pas Marx, n’ont élaboré des philosophies de la technique. Rien non plus chez Confucius ou Lao Tseu en Chine, ni chez Çankara ou Ramanuya en Inde. Pour finir, il n’y a qu’Aristote qui, aimant à prendre les choses par le bas, s’est arrêté devant les « objets techniques » en même temps qu’il s’arrêtait devant les « parties des animaux » (De partibus animalium). Et ce fut la fameuse théorie des quatre causes : pour produire techniquement un objet, par exemple un vase grec, il faut un but (cause finale), une matière (cause matérielle), une forme (cause formelle), un agent producteur (cause efficiente) ; à quoi les Médiévaux ajoutèrent parfois une cause instrumentale (un tour, un ciseau, un marteau). On le voit, dans cette vue, la cause finale, qui est la première et la dernière, est « la plus noble », celle qui justifie les autres. C’est elle qui fait que, pour les Grecs et les Romains, l’Univers méditerranéen fut un Cosmos-Mundus (non-immonde), dont Homo est le Microcosme.
Avec le succès planétaire des physiques et des techniques occidentales, la théorie aristotélicienne des quatre causes devint le modèle de toutes les causalités, humaines ou divines. Le modèle partagé par le garagiste, le chirurgien, le théologien, et par Jéhovah lui-même, cette Cause Efficiente qui a créé Adam en sculptant dans la matière (le limon) une forme dont la cause finale était « à son image et à sa ressemblance ».
C. Premiers éveils
Somme toute, il a fallu attendre les années 1930, avec « Technique et civilisation » de Mumford, pour que soit déclaré que toute civilisation et toute culture étaient d’abord une affaire de technique. Ainsi l’invention de l’échappement des roues d’horlogerie dans le Moyen Age finissant inaugura des horaires assez exacts et constants pour que l’Occident passe du cabotage maritime à la traversée océanique, puis de l’Atelier à la Manufacture, à l’Arsenal, à l’Usine, à l’Industrie, suscitant du même coup des Couvents et des Etats nations. Jusqu’à ce qu’Homo se découvre un « étant-au-monde temporel », le Dasein de Sein und Zeit de Heidegger, en 1927.
Et ce fut seulement en 1957 qu’un jeune doctorant français, Gilbert Simondon, osa un titre décisivement philosophique : Du mode d’existence des objets techniques. Oui, les objets techniques avaient une portée « pratique » mais aussi « existentielle ». Jusque là il y avait bien eu des « Histoires de la technique » et des « Musées de la technique », mais qui se contentaient de juxtaposer des descriptions et des datations de machines et de processus. Encore l’ouvrage révolutionnaire de Simondon fut-il peu remarqué. Trop technique pour les philosophes, trop philosophique pour les techniciens ? Ou tout simplement trop déroutant. Pensez donc ! Les objets techniques, ces esclaves de nos vies courantes, concerneraient, conditionneraient, porteraient la perception secrète que nous avons de nos existences ! Alors que l’existentialisme venait d’avancer que l’exister (sistere, ex, se tenir projeté vers) est la trame ultime de la destinée et de la liberté humaines.
Cependant, en 1959, l’auteur de la présente Anthropogénie tomba sur Du Mode d’existence des objets techniques. Il venait de publier Les Arts de l’Espace, où la peinture, la sculpture, l’architecture, les arts décoratifs étaient compris comme le produit de gestes techniques particuliers, des gestes capables de construire et d’entretenir les espaces-temps de groupes ou d’individus, comme les gestes techniques ordinaires, mais encore de thématiser ces espace-temps, voire de leur conférer un statut d’absolu (solvere, ab, délier de toute opérativité locale et transitoire), en les survoltant ou en les neutralisant. Comme il s’agissait d’arts de l’espace, ces espaces-temps thématisés et absolutisés furent appelés là : « sujet pictural », « sujet sculptural », « sujet architectural », autant de « sujets d’œuvre » ayant un sens par soi, indépendamment des thèmes descriptifs ou narratifs qu’ils portaient. Par leur sujet d’œuvre, une Joconde de Vinci, un David de Michel-Ange, une Chiesa de Borromini étaient un « Vinci », un « Michel-Ange », un « Borromini » avant d’être une Joconde, un David ou une Chiesa romaine. En Afrique, une statue de roi, d’antilope ou de singe étaient, par leur sujet d’œuvre, « Kuba » ou « Luba », et « Bambara » ou « Dogon », avant d’être un roi, une antilope ou un singe. Même si politiquement et rituellement ils l’étaient aussi.
Or, dans ces années 1960, Homo était en train de passer décisivement de ce que l’Anthropogénie appelle le MONDE 2, celui du « continu distant » de la Grèce et de l’Occident, au MONDE 3, celui du « discontinu » contemporain. Ce tournant violent tenait, bien sûr, à de nouvelles Sciences, de nouveaux Arts, de nouvelles Ethiques, mais aussi et plus initialement à une mutation de la Technique, en train de virer des « machines d’énergie », qui avaient régné depuis l’origine d’Homo, aux « machines d’information », dont la théorie avait commencé d’être explicitée par la Théorie de l’information et la Cybernétique de I948. Ce retournement avait été théâtralisé par deux Guerres mondiales. Inchoativement en 1914-18. Décisivement en 1940-45.
Ainsi, l’addition de Les Arts de l’espace et de Du mode d’eixstence des objets techniques donnèrent Le Nouvel Age, dont les trois chapitres sur la science, l’art et l’éthique étaient précédés par un chapitre sur la technique aussi considérable que les trois autres ensemble. En octobre 1963, Gilbert Simondon, qui achevait alors L’individu et sa genèse physico-biologique, qui parut en 1964, écrivit à l’auteur ces lignes que nous recopions (les italiques sont de nous) parce qu’elles éclairent les trois ouvrages : « J’admire la force des idées, la richesse de la documentation, et cette unité, ce pouvoir d’intégration qui fait de votre livre le témoignage d’une façon de penser ayant sa propre logique, sa propre axiomatique capable de rendre compte des modes de réalités en train d’apparaître par le processus des inventions techniques. En plus, ce travail possède une grande force esthétique capable de créer un lien, d’instaurer une communication, sous les espèces d’une activité du schématisme imaginatif ». Dans ce contexte, le terme « esthétique » voulait dire assurément une saisie des choses qui, dans les espaces-temps des productions humaines, - donc dans leur topologie, leur cybernétique, leur logico-sémiotique, leur présentivité, - perçoit leurs implications et leurs instaurations existentielles. Qu’il s’agisse d’objets usuels, de théories scientifiques, d’oeuvres d’art, de protocoles politiques ou religieux, de coutumes, etc.
C’est peut-être en raison de cette « esthétique généralisée » (l’ouvrage d’un autre auteur porta ce titre au même moment) que Le Nouvel Age de I962 eut beaucoup plus de retentissement que les deux ouvrages, pourtant remarquables, de Gilbert Simondon. L’Académie des sciences de Pologne, qui cherchait alors à ouvrir le marxisme soviétique à la modernité, et en particulier à la phénoménologie, s’empressa de le traduire en polonais, Nowy Wiek, quitte à ajouter une préface ayant une coloration sociopolitique qu’il n’avait pas. Au Canada, la même année que le Nouvel Age, 1962, Mc Luhan avait fortement éveillé l’attention sur la Technique par son raccourci génial : « The medium is the message », où était asséné en cinq mots que les structures techniques d’un media (radio, télévision, etc.) étaient par elles-mêmes un message (existentiel) plus fondamental que les messages particuliers qui y étaient véhiculés ; ainsi avait-il cru pouvoir distinguer des media « chauds » (la radio) et des media « froids » (la télévision). Ayant eu connaissance de Le Nouvel Age par son conseiller Jean Lemoyne, le premier ministre Trudeau mit à la disposition de l’auteur tous les moyens, sans oublier des équipes de cinéma, pour organiser un colloque international sur le thème : « La Technique et ses implications culturelles ».
Ce qui nous intéresse ici ce n’est pas que l’auteur n’ait pas saisi cette occasion ; peut-être que son penchant pour une « esthétique généralisée » le conduisait-il déjà à L’Intention sexuelle de 1965, et aux réflexions sur L’Industrial design de I970. Ce qui est remarquable c’est que le projet de colloque international sur la Technique, pourtant mûr, ne fut repris par personne. Quand, en 1990, la Société internationale de Métaphysique, regroupant une quarantaine de pays, consacra, dans son premier volume Person and Nature, un long chapitre à la Technique sous la signature de Janusz Kuczynski, ce fut encore en se référant presque exclusivement au Nouvel Age.
D. Quelques raisons de cette négligence
Pourquoi ce refoulement et même cette forclusion de la technique dans les ontologies et les épistémologies humaines ? Le thème mériterait des doctorats multiples. Contentons-nous de quelques suggestions.
(a) Homo, ce vivant bio-techno-sémiotique, quand il a fait les premiers systèmes de son Cosmos-Monde-World, est allé droit aux signes, et même aux signes les plus élevés : les astres, dans un mélange d’astrologie et d’astronomie, qu’on rencontre en Egypte et à Sumer, mais aussi à l’autre bout du monde, chez les Aborigènes d’Australie. Ensuite, devenu plus rationnel avec la « période axiale » (Jaspers) des années - 500, il s’est tourné vers des abstractions plus ou moins mathématiques : figures pythagoriciennes, idées platonicienne, topologies organiques des espèces éternelles d’Aristote, conversions mutuelle (Yi) du Yin et du Yang, Quick (sang épais universel) de l’Amérindien, Bon et Méchant du manichéisme. Comme si seul le sublime était capable de justifier Homo. Comme si de remarquer la part des techniques, trop contingentes, trop lourdement matérielles (guè-ôdès, disait Platon), aurait compromis sa justification comme espèce culminante.
(b) Homo a toujours attribué à ses langages des propriétés de révélation, de lucidité, de démonstration presque divines. Or, on humilie cette illusion si on reconnaît que les relations langagières (« dans les langues il n’y a que des différences », Saussure) ne sont que des spécifications et des thématisations des relations techniques dont elles se contentent de suspendre (mettre entre parenthèses) la dimension opératoire.
(c) La Technique n’est pas seulement un moyen mais un milieu. Et un milieu est largement indépendant de ce qu’il englobe, il a des développements imprévisibles, il domine plus encore qu’il ne sert. Reconnaître le statut de ‘milieu’ de la Technique dans la réalité humaine, c’est reconnaître la modestie de celle-ci. On peut penser que, pour que cette humilité devienne supportable, il aura fallu attendre les années 1960, lorsque Homo a commençé à se rendre compte que l’Evolution n’est nullement orthogénétique, mais buissonnante ; qu’elle n’est pas une montée constante vers lui, comme le croyait Spencer et Bergson autour de 1900, et encore Teilhardt de Chardin en 1950 ; que, pour parler comme Stephen Jay Gould, il n’y était qu’un « équilibre ponctué » parmi d’autres.
(e) Et on n’oubliera pas les raisons simplement épistémologiques. En effet, ce qu’Homo appelle ses idées, ses concepts, ses axiomes dépend surtout des aires corticales de son cerveau, lesquelles se caractérisent par leur vitesse et leur détermination ; ainsi, rien n’est plus facile que de spéculer, de contruire des système abstraits. Au contraire, les objets et les processus techniques relèvent largement du cerveau profond, par exemple des ganglions de la base et du tronc cérébral, lesquels ont des mémoires autonomes extrêmement performantes puisqu’elle permettent à un coiffeur ou à un pilote d’avion de retenir des milliers de nuances dans le maniement d’une paire de ciseaux ou d’un manche à ballet avion. Mais ces apprentissages solides sont très lents à acquérir et à modifier. Ainsi, les idées abstraites se passent d’un maître à un disciple, parfois en un instant, tandis qu’il faut souvent de longues années pour qu’une aptitude technique passe d’un maître à un apprenti.
(f) Et toujours épistémologiquement, l’ordre d’exposition et l’ordre d’invention ne sont pas les mêmes dans la technique et dans la philosophie. Descartes est si convaincu de jouer avec des idées « claires et distinctes », Spinoza avec des « idées adéquates », qu’ils croient tous deux pouvoir décrire un ordre d’exposition équivalent à leur ordre d’invention ; et ils écrivent des « discours de la méthode », des « règles pour la direction de l’esprit », une « éthique démontrée de manière géométrique » ; leur prétention rationaliste se retrouve même chez certains empiristes anglais. Or, pareille illusion n’est guère ou pas possible pour le technicien. Dans l’invention de la machine à vapeur par Watt, Simondon y insiste, les croisements de la théorie et de l’empirie sont si nombreux, si inextricables, en particulier entre invention analogique préalable et rectification digitale postérieure, qu’un discours de la méthode technique n’est pas envisageable. La tour Eiffel est un exemple populaire de la part des opérations ouvrières au jour le jour dans la construction-invention des objets techniques.
(g) Enfin, la confiance et la défiance d’Homo à l’égard de la Technique a une source ontologique. Il faut se rappeler que l’articulation primordiale dans l’Univers est la distinction : fonctionnements / présence (s). (Anth.Gén., ch.8), et que partout on retrouve chez Homo sa faveur pour les expériences de présence mettant les fonctionnements entre parenthèses : la musique, les arts de l’espace, les rites religieux, l’orgasme, toutes les formes banales de l’ivresse quotidienne, le nirvana, le dikr, le vaudou. Ces « expériences de sommet » (ces peak-experiences retrouvées par Maslow chez tous les étudiants d’une Université que leurs compagnons jugeaient d’avance « normaux ») tiennent en des mises entre parenthèses des fonctionnements, tantôt en neutralisant, tantôt en survoltant leurs effets de champ perceptivo-moteurs et logico-sémiotiques (Anth.Gén., ch.7), dans cette compatibilisation des incoordonnable qu’est le rythme, avec ses huit ressources (ibidem)
Or, la technique est du côté des fonctionnements, et le mot « rythme » n’y désigne guère que la régularité des cadences. Ainsi, Homo admire la technique, il la développe, elle l’absorbe, elle lui donne chaque matin ses buts immédiats. Mais c’est toujours un peu comme s’il s’agissait d’un préalable ou d’un fondement en vue de quelque chose d’autre, seul vraiment essentiel (« cause finale ») ; par exemple, le travail pour le loisir. Bouddha quitte la direction « technique » d’un royaume pour aller chercher le silence du sans souffle (nir-vana) où les fonctionnements sont abolis. Un PDG japonais quitte, du jour au lendemain, l’immense usine qu’il a mis sa vie entière à bâtir pour aller à l’écart contempler les cerisiers en fleur. Comme si la technique, si respectable soit-elle, n’était jamais le dernier mot, mais pour finir toujours un moyen, un jeu de ends and means. Même quand elle interroge les espaces infinis aux environs du bing bang pour tenter d’effleurer, de pressentir le Dernier Mot, la Question Ultime, censés d’une autre nature qu’elle.
Ainsi les philosophes, convaincus d’avance que la technique n’est pas ultime, auraient fini par oublier combien elle est néanmoins première, constamment première. L’Anthropogénie n’est pas une philosophie. Occupée d’origine, de genèse, de « génie », elle prend en compte les visées ultimes, mais à partir de leurs préalables. Surtout quand ces préalables, comme la Technique, peuvent être plus ou moins neutralisés, survoltés par des conduites « présentives » (favorisant la présence pure), mais jamais dépassés ni oubliés.
(h) Reste à préciser que la Technique n’a pas toujours eu le même poids dans la phylogenèse d’Homo. Malgré ses montées en puissance du paléolithique au néolithique, aux empires primaires, aux artisanats rationnels grec et romain, elle ébranla peu la Nature ; et cela même depuis que, vers l’An 1000, Homo occidental, ne voyant pas Christ revenir, décida de non seulement obéir à la Nature, mais de l’exploiter, en devenant un ingénieur, cocréateur à côté de l’Ingénieur Créateur. Les machines d’énergie créaient des perturbations locales, mais les forces naturelles, incommensurablement plus puissantes, rétablissaient bientôt les équilibres écologiques compromis. Les systèmes économiques et politiques gardaient l’illusion de gouverner le monde. Encore en I948, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Etats se proclamaient « souverains ».
Il n’en va plus de même depuis le règne des machines d’information, au lendemain de la seconde Guerre mondiale. Autant le savoir-faire des machines d’énergie était lent à transmettre, autant celui des machines d’information est rapidement déchiffrable et assimilable, en même temps qu’il est globalement transmis par le développement des communications qu’il génère. En cinquante ans, le couple énergie-information a modifié les équilibres écologiques de la Planète entière, c’est-à-dire ses climats et ses espèces vivantes. Homo technicien a aujourd’hui plusieurs des propriétés de cet Ingénieur omniprésent qu’autrefois il imaginait être le Démiurge de son Univers. En 2007, il espère en 2008 recréer au CERN plusieurs des conditions du big bang. Urgences qui détournent encore davantage de toute philosophie de la Technique. Ou occasion d’y rêvasser dans des moments de relâche de plus en plus rares.
Chapitre 1 - LES TROIS VISAGES DE LA MACHINE
En abordant l'histoire de la technique, le sociologue a la satisfaction d'y retrouver les mêmes étapes, quel que soit le point de vue envisagé. Qu'il s'intéresse dans la machine à ses grands types de fonctionnement, à ses incidences politiques ou artistiques, à l'optimisme ou au pessimisme qu'elle a suscités, il est toujours reconduit à considérer trois époques : ce qui précède la révolution industrielle, la révolution industrielle elle-même, enfin nos années. Bien entendu, on discutera des dates précises, on se demandera quels faits plutôt que d'autres ont décidé du début et de la portée des grands âges. Mais les articulations d'ensemble demeurent, et Mumford en a donné une expression classique en distinguant une ère éotechnique, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, une ère paléotechnique, qui couvre le XIXe et le début du XXe, et une ère néotechnique, que nous inaugurons [1].
Nous n'échapperons pas à une division semblable. C'est peut-être le progrès le plus substantiel de la réflexion en la matière que d'avoir cessé de parler de la machine en général, pour y distinguer trois stades, trois visages, violemment contrastés, et ayant suscité des réactions culturelles très diverses. On ne peut aller droit au dernier, au nôtre, car ses prédécesseurs inspirent encore nos philosophies optimistes ou pessimistes comme aussi nos options quotidiennes, irritées ou fascinées, à son égard. Et d'ailleurs les stades les plus avancés d'une technique continuent de comprendre les premiers comme éléments : le faîte reste porté et conditionné par les étages.
Il nous faut donc faire retour au passé dans le but de saisir génétiquement les articulations, les stratifications des engins actuels, et nos réactions émotives à leur endroit. En termes prétentieux, notre recherche se voudrait non historique mais phénomé nologique et structurelle, - comme il convient à un avènement de culture réfléchi.
1A. LA MACHINE STATIQUE
La paléontologie fait dater l'apparition de l'homme de celle de ses outils. Aiguilles et peignes d'os, haches et flèches de silex prouvent, à ses yeux, plus que la forme et le volume d'un crâne. Ce sont en effet des moyens de transformation dont les relations internes et externes montrent bien que leurs fonctions ont été saisies comme telles, comme un univers « second » - la technique - capable à son tour d'être transformé, développé. Le singe de Kœhler, s'avisant de prendre un bâton pour atteindre une banane, invente un outil transitoire, qui pour autant n'en est pas un. L'outil vrai se stabilise, se détache, renvoie à d'autres artifices complémentaires et à son propre développement. Il suppose un pouvoir de symbolisation, d'objectivation, de prise de distance propre à l'homme. La manière dont son idée implique celle de système invite à mettre son développement en relation avec celui du système par excellence : la langue [2].
Quels ont été les premiers principes machiniques mis en usage ? Dès le paléolithique, des représentations rupestres de pièges à fauves montrent comment l'animal, en touchant le fond, déclenchait sur lui la chute de troncs d'arbres biseautés : c'était avoir mis en œuvre le principe du levier. Mais le vrai départ de la machine commence à l'ère néolithique avec la roue. Dans l'emboîtement du disque et de l'axe, celle-ci apportait une application plus riche des fonctions conjuguées et achevait de munir la première Antiquité pour son essor. Levier et roue, avec leurs dérivés, la poulie, le treuil, l'engrenage, le tour, - tous engins de démultiplication des forces, - suffiraient à porter, dans la guerre et dans la paix, les cultures agraires du Nil, de l'Euphrate, du Gange et du fleuve Jaune.
Il n'en fallut pas beaucoup plus à l'Antiquité classique et au premier Moyen Age. Pour des raisons religieuses et sociales [3], les Anciens furent moins ingénieurs qu'astronomes et physiciens, et la pauvreté mécanique de leurs sabliers et de leurs clepsydres contraste avec le raffinement mathématique de leurs cadrans solaires. Même leur vocabulaire nous déçoit ; le grec Mèchanè et le latin Machina désignent le côté d'astuce, de surprise, d'efficacité brutale des engins plutôt que leurs caractères proprement machiniques d'indépendance et d'automaticité [4]. Si Ctésibios invente une pompe aspirante et foulante, si Héron d'Alexandrie utilise la pression de l'eau et de l'air chauffés, c'est principalement pour combiner des automates à des fins ludiques ou cultuelles. Somme toute, il n'y a qu'un domaine où les techniciens antiques prirent leurs dons au sérieux : celui des machines de guerre, surtout des catapultes à torsion, où d'ailleurs ils eurent tôt fait de transformer les enseignements de Philon de Byzance, de Vitruve et d'Héron en recettes empiriques. Pour le reste, les Romains utilisent dans leurs mines d'Espagne des chapelets de vis d'Archimède afin d'éliminer les eaux ; ils développent les norias et, à la veille de l'ère chrétienne, les moulins à eau. Mais ces inventions remarquables n'apportent pas la révolution technique dont elles étaient susceptibles, et même en architecture, où ils eurent pourtant le mérite de perfectionner les procédés du clavage, nous voyons les citoyens de l'Empire continuer à recourir à la solution dispendieuse des aqueducs à plan incliné, alors qu'on avait appliqué à Pergame, dès le IIe siècle avant notre ère, le principe des vases communicants. Tant il est vrai que la connaissance technique n'est pas simplement cumulative et suppose un esprit qui décide de l'exploiter ou de la laisser en friche. Schuhl parle de la mentalité « prémécanicienne », voire « antimécanicienne » de l'Antiquité [5].
La civilisation occidentale, à partir du fatidique an mil, va profondément modifier cette attitude. Si la technique jusque-là visait des fins sans trop se préoccuper des moyens, c'est qu'elle disposait abondamment d'esclaves, force motrice faible, chère à nourrir, mais mobile. La chute de l'Empire jointe à une réflexion progressive sur les implications du christianisme tarira cette ressource ; le premier but de la technique sera désormais, avant même la poursuite des résultats, d'alléger le fardeau de l'homme, - ce qui eut pour effet de favoriser grandement les résultats. Et l'Occident va se lancer dans une prodigieuse recherche et exploitation des forces extérieures : forces de l'animal dans la ferrure et le harnais ; forces physiques dans le développement incessant des roues hydrauliques, des moulins à vent venus de l'Islam, de la voilure des vaisseaux ; forces de régulation dans le gouvernail fixe et le métier à tisser à pédales ; forces chimiques dans la poudre à canon et surtout dans la distillation des acides sulfuriques et nitriques, adjuvants du métallurgiste ; tout cela entraînant l'usage de supports légers et idoines : le verre incolore, milieu des réactions chimiques, et le papier, conjoint bientôt aux caractères mobiles et à la presse à imprimer [6].
Et pourtant, ces conquêtes qui prennent place entre le Xe et le XIIIe siècles, s'estompent presque devant une autre, contemporaine [7] : l'horloge mécanique, dite encore à poids ou à échappement. L'événement est l'un des plus considérables de l'histoire. Spengler y voit le symbole de la culture nouvelle, parce que la sonnerie régulière, puis l'aiguille sur le cadran allaient manifester une obsession de la durée exacte et efficace, inconnue des Chinois, des Indiens, des Grecs, et pénétrant toutes nos créations. Mumford en fait dater l'ère « éotechnique » proprement dite et souligne que l'horloge, engendrée par les besoins de régularité des monastères, allait fournir à l'homme occidental ce cadre abstrait, rigide, indépendant du temps vécu des saisons, qui l'inviterait à concevoir le passé comme tel (qu'on songe aux résurrections historiques de la Renaissance, du Classicisme et du Romantisme), à se repérer rigoureusement dans l'espace (voyons la boussole, le compas de navigation, la cartographie, les explorations territoriales), à s'intéresser aux grandeurs et aux puissances pures (éléments du capitalisme), enfin à engendrer ces résumés de précision, de régularité, de synchronisation, d'accélération que sont nos machines.
Car, du point de vue machinique, l'échappement n'est pas un simple progrès mais une mutation. Rien dans le déclenchement de l'arc ou de la catapulte, ni dans le basculement rythmique de la noria ne présage l'idée de cette oscillation retenant et libérant alternativement le mouvement [8] . Dès lors, le nouvel esprit mécanicien est né. Il sera possible d'envisager la répétition indéfinie d'une action identique, moyennant un remontage. Il sera possible même de combiner d'avance une succession d'actions différentes : l'horloge à poids contient en germe non seulement le calendrier perpétuel de Strasbourg, mais tous les automates qui illustreront l'horlogerie suisse des XVIIe et XVIIIe siècles. Et si l'on méprisait tant de virtuosité gratuite, qu'on se souvienne que le procédé, sous la forme du sautoir, alimente la machine arithmétique de Pascal, et que la came, qui appartient au même esprit, est à la source de tous nos engins de modèlement.
Telle fut en substance la technique, de ses origines aux années 1750, puisque les grandes découvertes scientifiques de la Renaissance et du Baroque ne sortirent leurs applications industrielles que très tard. On peut la voir culminer dans la navigation du XVIIIe siècle. étant donné la situation de leurs colonies, Portugais et Espagnols longeaient les côtes jusqu'à la latitude du pays à atteindre, puis suivaient le parallèle, calculé par la hauteur angulaire de l'étoile polaire, selon un procédé déjà connu des Grecs. En raison de leurs rivalités, et parce que leurs colonies se trouvaient dans les hautes latitudes où le parallèle fait un détour plus sensible, Anglais et Français se livrèrent à une compétition acharnée pour réaliser une navigation en ligne droite, qui supposait le calcul délicat des longitudes. Il y fallait soit des chronomètres soit des instruments d'optique, dont le raffinement mit en œuvre des tours et des machines à diviser qui sont les ancêtres directs de tout notre outillage. Muni de ces ultimes précisions horlogères, de sa redoutable artillerie, de sa prodigieuse voilure, un vaisseau de l'amirauté de Louis XVI résume la technique ancienne [9].
Si la machine en était restée à ce stade mécanique, où elle se contentait de transmettre directement ou indirectement du mouvement [10], elle n'aurait guère posé de problème, et l'on ne voit pas que les philosophes du temps s'en soient beaucoup préoccupés. Ils avaient conclu seulement qu'elle était, comme les outils et les ustensiles de toutes sortes, un objet artificiel, par opposition aux êtres vivants et aux minéraux, et qu'elle avait une causalité un peu particulière, qu'Aristote avait appelée instrumentale. Pour autant, ils la tenaient en piètre estime comme tout ce qui concernait la réalisation pratique et le travail manuel, indignes d'un homme libre, mais sans y trouver rien d'inquiétant [11]. Qu'était-ce qu'une poulie, un treuil, une catapulte, un bélier de siège, même une horloge à poids ou une pompe, sinon un geste prolongé dans un membre semblable à nos membres, pareil au bras qui enroule, dévide, balance, tournoie, à la main qui boucle, accroche, relâche en cadence ? Et c'est en effet l'image du corps accru qu'allèguent le plus souvent les théoriciens. D'ailleurs, le matériau presque exclusif était le bois, le plus docile, le plus proche du corps humain, tandis que le fer, avec les violences du mineur et du forgeron [12], restait l'exception. Quant aux moulins et aux voiliers, s'ils faisaient autre chose que prolonger un geste, ils n'en continuaient pas moins de capter de façon très visible les éléments les plus familiers. Orateurs, poètes, décorateurs, liturgistes eurent là, durant des millénaires, un inépuisable arsenal d'images comprises de tous et rassurantes. Le caractère naturel est même si propre à ces formes d'énergie qu'il en explique la qualité et le défaut : rendement très élevé contrastant avec le gaspillage des machines à vapeur, et irrégularité due aux caprices des saisons.
La sympathie cosmique se renforçait par le mode d'apprentissage : intuitif, celui-ci consistait en l'acquisition d'un tour de main. Les choses étaient censées receler des pouvoirs mystérieux que l'artisan dégageait dans un contact intime ressemblant à un apprivoisement, à un domptage ; le modeleur éprouvait la glaise à fleur de paume, le paysan savait la terre et la pluie dans un toucher de tout le corps.
L'interposition de l'outil et de la machine y changeait peu : instruments de contact, ils participaient à la proximité du geste ouvrier. D'où le caractère initiatique de l'enseignement, tant chez les primitifs que dans nos corporations, qui achèvent de témoigner pour les vertus de la machine ancienne en liant l'homme à la société autant qu'à la nature : le tour de main supposait le commerce direct et quotidien du maître, dont on recevait la « maîtrise » dans une sorte de filiation. De semblables rapports de travail engendrèrent des structures sociales généralement stables et chaudes, malgré les inégalités. On notera seulement une évolution depuis l'Antiquité, contente de se soumettre à l'ordre du monde, jusqu'à la Renaissance, pressée de l'exploiter. Mais que la technique pour Francis Bacon soit « l'homme ajouté à la nature » ne comporte, comme pour Descartes, aucune idée de violence. A leurs yeux, nous agissons sur e!le - d'ailleurs plus en désir qu'en acte - en agissant comme elle, selon une formule chère à Marsile Ficin.
Ce tableau paraîtra idyllique pour la fin de la période. Les industries nouvelles, - mine, verre, imprimerie, - durent beaucoup au capitalisme, qui s'empressa de les soustraire aux règlements sociaux de la corporation. D'autre part, c'est dans la mousqueterie qu'apparurent pour la première fois les avantages de la production en masse, ce qui engendra une collusion entre technique et militarisme qui fit de l'armée en campagne et de l'industrie sur pied de guerre l'idéal de maints techniciens. Enfin, l'accroissement bénéfique de la demande dépendit, à travers le luxe bourgeois, de celui des grandes courtisanes [13]. Mais ces alliances douteuses concernent plus l'atmosphère favorable à l'objet éotechnique que lui-même, et ne compromettent pas le tableau rassurant que nous avons brossé. Capitalisme, militarisme et luxe de cour, tout en introduisant des tares, gardèrent une signification culturelle considérable, comme en témoignent les réalisations urbanistiques du XVIIe siècle.
La Grande Encyclopédie parut, autour de 1700, en conclusion et comme en apothéose de cette ère [14]. Empressons-nous de dire qu'elle annonçait déjà, par plus d'un trait, l'âge nouveau. Elle inaugurait la compréhension scientifique de la machine en l'éclairant des lois de la mécanique édifiée par Galilée, Descartes, Leibniz, Newton, et ainsi dépassait l'habileté fortuite et incommunicable des techniciens antérieurs. Mais c'est un de ces moments exceptionnels où l'humanité glisse d'une phase à une autre en conjuguant les bénéfices et en neutralisant l'un par l'autre les inconvénients. La machine y est scientifique sans laisser d'être intuitive. Elle n'abolit pas le tour de main, elle l'explicite plutôt et le rend transparent à lui-même, conjoignant corps et raison. Ce merveilleux et précaire équilibre culmine dans les quinze volumes de planches, qui parlent à la fois à l'esprit, à l'œil, au geste, et conjoignent les vertus du chiffre, qui sera le monde de l'avenir méconnu par Vinci, avec la saisie simultanée du regard, que Vinci, en parfait Renaissant, avait exaltée comme la fruition suprême. Tout cela reste à la mesure de l'homme, jusque dans les apparences : la machine fait figure de meuble dans la maison, à moins que, moulin pour le meunier, elle ne soit maison elle-même. D'ailleurs, dans sa partie illustrative, qu'est l'Encyclopédie sinon un atelier idéal où toutes les machines seraient rassemblées en un ordre clos, à portée de la main, dans la forme semi-mentale de l'imprimé ?
Mais, répétons-le, elle fut une transition. En pénétrant la machine de science, elle l'exposait à devenir l'instrument d'une production abstraite, échappant à la mesure de l'homme. Du même coup, elle enlevait à l'apprentissage son caractère initiatique et le mettait à la portée de quiconque voulait faire un effort : c'était ébranler les privilèges corporatifs et tout l'ancien régime. L'Encyclopédie prélude donc directement à la Révolution industrielle et à la Révolution française. Elle conclut le premier âge de la machine en ouvrant le second.
1B. LA MACHINE DYNAMIQUE
On n'est pas d'accord sur les débuts de la Révolution industrielle. Il a été de mode d'y voir une conséquence des guerres napoléoniennes : celles-ci ont stimulé la découverte et, par les armées nationales avec leur logistique complexe, ont mis l'Europe occidentale en état d'industrialisation. Gênés par cette thèse peu flatteuse pour l'humanité, des historiens pacifistes comme John U. Nef ont souligné, au contraire, que les jeux étaient faits depuis 1785 et qu'il faut donc plutôt invoquer l'ère de paix exceptionnelle qu'avait été le XVIIIe siècle, première esquisse d'une Europe unie [15]. Au vrai, dans la guerre comme dans la paix, la Révolution industrielle eut des ancêtres lointains. Ses engins les plus caractéristiques, - la machine à vapeur, le haut fourneau à charbon, le métier à tisser automatique, - sont l'aboutissement de centaines d'inventions de détail, dont on suit la filière serrée dès le XVIIe siècle, la Renaissance et même antérieurement. Et nous savons que le capitalisme, le luxe de cour et l'esprit d'enrégimentement militariste qui allaient favoriser la mentalité industrielle avaient d'anciennes lettres de créance. Car il faut voir que cette Révolution fut autant un climat général qu'une effervescence machinique. Si, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, le besoin d'une machine à vapeur de bon rendement se fit de plus en plus pressant, c'est que de graves problèmes commerciaux se posaient tantôt à des filateurs débordés par la demande des tisserands, tantôt à des tisserands ne parvenant pas à suivre l'offre des filateurs, alternative exaspérée par une curieuse loi qui supprima un temps les droits sur les soieries et les cotonnades des Indes pour fouetter délibérément le textile anglais. La Révolution industrielle apparaît donc comme un confluent où se croisent la technique (puddlage du fer en 1783), l'économie (suppression des derniers privilèges des corporations et extension des marchés sous l'influence du libéralisme de Smith), la politique extérieure (colonisation des Indes) et intérieure (exode des paysans anglais vers les villes sous la pression des gentlemen-farmers), le tout animé par ce qu'il faut bien appeler une mentalité nouvelle [16], où la ferveur calviniste eut la plus grande part [17].
Quoi qu'il en soit des temps et des causes, autour de 1800 la machine montre un nouveau visage. Elle cesse d'être un moyen innocent d'alléger quelque peu les tâches humaines et d'assurer, vaille que vaille, une subsistance au jour le jour, pour apparaître comme un instrument de puissance indéfinie destiné à satisfaire des besoins également indéfinis. On peut prendre pour signal de cette mutation le passage de la machine de Newcomen à celle de Watt. Dans la Newcomen, la vapeur avait pour effet de repousser le piston, alors poussé par la pression atmosphérique : le travail dépendait de celui, fatalement limité, d'une force naturelle, le poids de l’air ; nous étions toujours dans le monde du moulin à vent et à eau. Watt retourne le problème : dorénavant, c'est la vapeur qui poussera, assumant le temps moteur, et comme on peut accroître indéfiniment sa pression, la puissance elle aussi sera indéfiniment multipliable [18]. Ainsi les commandes passent de la nature à l'homme : l'énergétisme, tel que le développeront la thermodynamique et bientôt l'électrodynamique, est né. Il trouvera du reste un allié puissant dans un principe déjà ancien, mais qui prend un nouveau départ à son contact : l'organisation. Et la machine, qui depuis ses origines n'avait guère alerté les hommes de culture, se prit à inspirer une morale et presque une religion : celle de l'efficacité, de la quantité, du rendement, du progrès, par la force brute dans la machine à vapeur, par la force organisée dans le métier à tisser ou le téléphone. Le chemin de fer fut le chef-d'œuvre de l'époque pour avoir conjugué ces deux grandeurs.
Il y eut les optimistes à qui la vapeur, bientôt l'électricité et le pétrole, semblaient promettre le salut universel. Marx voyait bien que les engins nouveaux aliénaient le prolétariat, qu'ils favorisaient la « dégradante division du travail », mais c'était à ses yeux un inconvénient transitoire qui tenait essentiellement à l'emprise du capitalisme : il suffirait de renverser celui-ci et de donner à l'ouvrier la possession de ses instruments de travail pour entraîner des jours meilleurs. Un Berthelot se montrait plus confiant encore lorsqu'il estimait que les nouveaux instruments s'appliquant à la synthèse chimique dont il était le promoteur, non seulement combleraient les besoins matériels de l'être humain, mais engendreraient fatalement, par la surabondance, un régime politique assurant le bonheur et la vertu. Il faisait ainsi, en technocrate avant la lettre, l'économie de la révolution, où Marx .voyait un marchepied presque partout nécessaire.
Mais la grande majorité des hommes de culture se montrèrent sombres, estimant que les inconvénients de ce qu'ils commençaient d'appeler le monde moderne étaient liés à son être même. Il n'y eut pas seulement la longue plainte des poètes, de Vigny à Rilke, en passant par les fureurs de Nietzsche. Flaubert, qui tenta une saisie du siècle à bras-le-corps, fit la preuve qu'il était possible d'élever au style la Carthage ou l'Alexandrie anciennes, voire la province encore traditionnelle de Madame Bovary, mais non ce qu'il y avait, dans les institutions et les choses, de proprement XIXe siècle ; l'échec de L'éducation sentimentale prélude à celui du naturalisme. Les peintres, plus radicaux, prirent le parti de taire un monde qui leur échappait : les ateliers de la Renaissance entraient de plain-pied dans les tableaux de Dürer et les moulins du XVIIe siècle dans ceux de Rembrandt ; la locomotive, malgré le premier enthousiasme de Turner, ne devint picturale qu'à travers les brouillards de l'impressionnisme [19]. Seuls les architectes-ingénieurs étaient confiants dans l'acier et le béton, encore qu'ils les employassent d'habitude pour simplement agrandir une architecture ancienne sans caractère. Le désarroi général s'exprime bien dans les contradictions des esthéticiens du temps, qui ballottent entre la vérité nue du pur fonctionnel, indigente vu l'élémentarité de la machine de l'époque, et le mensonge de l'ornement qui aboutit au modem style : on supporta des culasses par des colonnes corinthiennes, on en dissimula derrière des tapisseries [20]. Ruskin est sans doute logique quand il prêche la fuite d'un monde qui lui semble dégradé et le retour à la nature, source de vie. Son avis est partagé par des moralistes moins esthètes ; dans le mythe d'Erewhon, en 1872, Butler, supposant que les machines obéissent à la sélection naturelle de Darwin et qu'elles sont parvenues au moment d'évincer l'homme, propose la seule mesure salvatrice : leur destruction.
Il entre assurément beaucoup de préjugés, beaucoup d'ignorance dans ces manières de voir. Mais enfin, une condamnation si unanime et si persistante visait incontestablement plus loin que les tares politiques dénoncées par Marx et devait tenir à quelque caractère profond des nouveaux objets. Suffit-il alors, pour expliquer le malaise, de dire que l'environnement de fumées, de poussières et de scories, à Pittsburg et ailleurs, plaçait le patron nanti dans une situation presque aussi morne que ses ouvriers rachitiques ? Que, pour la première fois dans l'histoire, une civilisation entière reposait sur la mine, la plus inhumaine et la plus arriérée des industries ? Que le culte du rendement exigeait de tous une contention qui engendra les étroitesses terre à terre de la morale victorienne et une conception barbare de l'école, assurant l'instruction mais aussi la discipline dépersonnalisante requise par les nouveaux emplois [21] ?
L'explication est trop simple. Les pays sont très différents à cet égard, et l'Allemagne ne connut jamais les excès monstrueux de l'Angleterre [22]. De plus, les hideurs caractérisent la machine dynamique dans le couple charbon-acier de ses débuts, mais elles s'atténuent dans le couple électricité-aluminium dès 1850 et dans le couple pétrole-métaux spéciaux dès 1880. L'appareillage électrique invite à la propreté, à la finesse, à la géométrie ; le courant, facilement transportable en tous les points de l'atelier ou de la région, suggère la décentralisation industrielle en libérant les machines de l'arbre de transmission unique de la machine à vapeur [23] ; le pétrole produit le même effet et, permettant l'automobile, libère les centres engorgés par la fatale convergence des lignes de chemin de fer. Tout cela ne favorise-t-il pas une vie franche et salubre ? Mumford en était si convaincu qu'à la suite de Lénine il a vu dans l'électrification, le pétrole et le téléphone la possibilité d'une ère nouvelle, « néotechnique », relayant l'ère « paléotechnique » du charbon et de l'acier, à la condition que les hommes tirent les conséquences économiques et politiques de leurs nouveaux pouvoirs. Sous l'angle du laid, du sale et de la fatigue, les défauts de la machine dynamique semblaient donc corrigibles et ne pas tenir à son être même. Or les critiques ne se montrèrent pas satisfaits pour si peu. Pas plus que sur les injustices sociales, ils n'appuient leur argumentation essentielle sur les laideurs et les brutalités et, contrairement à l'opinion de Mumford, un passage complet à l'électricité - s'il est possible - n'aurait pas dénoué le nœud du problème. Quel est-il, si l'on essaye de remonter au-delà des formulations maladroites et passionnées ?
1B1. La machine dynamique d'énergie
La machine énergétique du XIXe siècle est en rupture avec l'homme et avec la nature. La machine mécanique qui l'avait précédée prolongeait le corps humain et les forces naturelles : moulins, voiliers, même les pompes et les presses, captaient l'eau et le vent selon leur débit propre, les mettaient en œuvre sans travestissement, les utilisaient sur place [24]. Au contraire, la locomotive, le haut fourneau, la turbine électrique et le moteur à explosion, non seulement s'isolent de l'ouvrier mais, au lieu d'épouser les forces naturelles, ils les attisent de toutes les manières ; ils les transmuent d'une forme dans une autre, - mécanique, thermique, électrique, chimique, - et c'est même à ce propos que sera découvert le concept de l'énergie et le principe de sa conservation ; ils les transportent en tous lieux sans rappel de leur origine. D'où le sentiment, exprimé par les témoins, de se trouver devant un nouvel être qui, même quand il n'était pas effrayant comme les premiers hauts fourneaux, ni coupable de viol comme l'usine et le chemin de fer déflorant le paysage, restait inassimilable par la culture et les systèmes de valeurs consacrés, puisqu'on n'y connaissait que l'homme, la nature et quelques objets les reliant. Après les engins d'autrefois, semi-artificiels, la machine énergétique est un artifice consommé, formant un règne à part, insolite.
De plus, un moyen ne nous paraît naturel que s'il se rattache visiblement à une fin concrète : moudre du grain, lever une pierre au haut d'un mur, teindre un vêtement. C'était le cas de la machine mécanique dont l'énergie était polyvalente en droit (on pouvait l'utiliser à mille choses) mais en fait se limitait à une tâche à laquelle elle était « consacrée ». La machine énergétique brise cette liaison : sa fin n'est plus de faire une action concrète, mais de produire de l'énergie en général. Elle est un moyen de moyen. Elle inaugure le règne du pur moyen, aussi distinct de l'homme et de la nature, aussi insolite, - d'aucuns diront : monstrueux, - que le règne du pur artifice.
Elle a même, en plus de son étrangeté, quelque chose d'agressif pour le vivant. Alors qu'il se ravise, adapte des opérations toujours neuves, et opère par synthèse et par continuité, elle va droit devant elle, répétant inlassablement la même action, analysant à l'extrême ses processus. Cela se tolérait dans le tic-tac lent de l'horloge et du moulin, proches des rythmes vitaux, mais, dans la vitesse centuplée des concentrations d'énergie, montre un inquiétant visage, celui de la matière nue. La poussée linéaire, la multiplication numérique, la fragmentation analytique sont les caractères mêmes de la matérialité. Sous l'effet de l'accélération, elles prennent un relief, une pureté qui fait de l'aller et retour obsédé du piston, de la bielle et de la roue, l'antipode vertigineux de la vie. La honte pour celle-ci, c'est que pareil aveuglement se révèle, en bien des cas, plus efficace que ses souplesses. Le vivant se sentit dépossédé.
Il ne lui restait plus qu'à s'obliger à prendre lui-même les façons d'être de l'envahisseur. N'insistons pas trop sur le travail à la chaîne, qui donne au geste une stéréotypie où l'homme se modèle sur la machine, où il la « sert » en une instrumentante à rebours : c'est là une conséquence qui s'inscrit dans la logique de l'énergétisme mais qui n'appartient peut-être pas à son essence ; de droit, il tend aussi bien à réduire les tâches du manœuvre. Plus fondamentale fut l'emprise sur l'intelligence de l'usager, de l'ouvrier, voire de l'inventeur. En effet, la machine énergétique n'appartient ni à l'expérience vécue de l'ancien tour de main, ni à la vraie connaissance scientifique. Rien là de scandaleux, dira-t-on, puisque entre la fonction non critiquée de l'empirie et le fait critiqué de la science, il y a place pour un troisième ordre : celui de la fonction critiquée, qui appartient à la technique moderne [25]. Mais justement, dans le monde dynamiste, la fonction réduite à elle-même (moyen de moyen) est si pauvre, si matérielle, qu'elle n'a jamais pu se tailler une province bien définie au royaume de la connaissance, et nous voyons la plupart des techniciens de l'époque hésiter entre le statut de trouveurs empiriques, et celui, aussi peu glorieux, de simples applicateurs de théories savantes. A cela, plus qu'à une prétendue modestie ou incapacité d'expression, il faut attribuer que les techniciens du XIXe siècle se confinent dans les problèmes de métier et répugnent à toute idée générale sur la technique, sauf pour affirmer une foi irréfléchie dans le progrès quantitatif ou, plus souvent, pour se situer eux-mêmes en dehors de la culture, fief, à leurs yeux, du philosophe, du littérateur, de l'artiste et, depuis peu, de l'homme de science [26].
Cet état de choses eut un retentissement sur les relations sociales. Il est assurément difficile de faire le départ entre les abus du capitalisme critiqué par Marx et les méfaits de la machine énergétique. Mais aux classes engendrées par les structures économiques, celle-ci vint ajouter, ou superposer, trois classes également « aliénantes ». L'homme d'affaires l'utilise à des fins économiques ou politiques, et cela d'autant plus arbitrairement qu'elle n'a pas de finalité intrinsèque ; du coup il est mis en question, et par cet arbitraire même, et par son ignorance à l'égard des instruments sur lesquels il s'appuie et qu'il doit se contenter d'exploiter. Le technicien, ingénieur ou contremaître, comprend ses instruments, - bien qu'il s'éprouve comme un savant bâtard, - mais en retour il est exclu de la décision des fins, extrinsèques à la machine et relevant de l'homme d'affaires ou du politicien. Enfin l'ouvrier, simple cheptel de fonctionnement, est exclu tant de la vraie compréhension de la machine que de celle des buts poursuivis. Et ce qui prouve qu'il s'agit là de caractères liés au statut machinique énergétique, c'est qu'on les retrouve dans la Russie stalinienne, où l'arbitraire de l'homme d'affaires - le planificateur - s'illustre par ce que les critiques russes ont appelé depuis « subjectivisme économique » ; le malaise du technicien par le drame de l'intelligentsia ; le cheptel de fonctionnement par les camps de travail [27]. Le désarroi social se trahit au mieux dans la dispersion architecturale de l'époque : à part quelques tentatives urbanistiques d'inspiration policière, comme celle d'Haussmann à Paris, jamais l'espace de la demeure, de la cité, de la route ne fut plus incohérent qu'au XIXe siècle.
Enfin, les adversaires de la machine dynamiste la jugèrent nuisible jusque dans ses avantages culturels. Et ils rejetèrent un à un les trois arguments avancés par ses rares défenseurs, en particulier les technocrates américains de 1920 [28]. Vous dites que la machine augmente les loisirs ? Mais parler de la sorte, c'est accepter une dichotomie où la vraie vie n'est nulle part, ni dans le travail, pis aller préparatoire au loisir, ni dans le loisir qui, privé d'articulation sur le travail, se vide de substance. Elle libère le travail des contraintes sordides et, avec les développements de l'électricité et des métaux spéciaux, va jusqu'à le parer d'un ordre et d'une fonctionnalité esthétiques ? Mais, pour humaniser un travail il ne suffit pas de l'alléger, il faut le rendre signifiant : or l'esthétique du styling, si elle se réduit au fini de la matière, à l'arrondi de la figure et à un certain rappel des êtres vivants invoqué par Mumford, ne nous promet rien de plus qu'un vain repos de l'œil ; et il y a peu à attendre de la fonctionnalité si la fonction du moyen-de-moyen est sans contenu spirituel. La machine énergétique comporte la suppression de la rareté [29] et par là des privilèges et des classes sociales ? Nous venons de voir au contraire qu'elle implique une nouvelle division en classes - celles de l'homme d'affaires, du technicien, de l'exécutant - plus aliénante que l'ancienne. D'où que nous la prenions, nous sommes au rouet.
1B2. La machine dynamique d’ordre
Le monde technique ne compte pas que des machines d'énergie. Il lui en faut qui produisent des formes, des arrangements, plus spatiaux dans les machines de modèlement [30], plus temporels dans les machines d'information. Le XIXe siècle fut riche en ces deux genres. Il perfectionna le métier à filer, à tisser ; il mécanisa l'imprimerie, la semeuse, la moissonneuse. Il fut révolutionnaire en créant le télégraphe, le téléphone, le cinéma, la radio.
Pourtant, il ne vit guère dans ses machines d'information qu'un moyen nouveau d'actionner à distance ses machines de modèlement, et dans celles-ci qu'un moyen indirect de favoriser encore sa production d'énergie. Il n'aperçut pas l'originalité technique de l'information, qui est de pouvoir spéculer sur le temps et de ménager ainsi des actions en retour. Il ne saisit pas davantage l'originalité de l'ordre comme principe physique et technique universel distinct de l'énergie. Il reste à tous égards énergétique. On ne s'étonnera donc pas qu'ici également il ait prêté le flanc aux reproches. Dans son utilisation technique des machines d'ordre, on retrouve partout l'accélération de mouvements linéaires, récurrents, analytiques, le moyen-de-moyen, la dépendance de l'homme à l'égard de l'outil.
Que dire néanmoins de la façon dont le XIXe siècle finissant et le XXe siècle en ses débuts employèrent la presse, le phonographe, le cinéma, la radio, bientôt la télévision, pour multiplier des réalités directement culturelles, le texte, la voix, la musique, le geste ? N'était-ce pas apporter à la vie de l'esprit, outre une diffusion démocratique, les échanges intenses et variés où les sociologues ont toujours vu son principal moteur ? Même ici les critiques ne se rendirent point. La culture est un artifice, dirent-ils, mais qui a pour fin de nous mettre en contact avec le réel ; or l'information proliférante fait écran entre l'esprit et les choses, et c'est d'ailleurs en ce sens qu'elle est passive : non qu'elle provoquerait la somnolence, mais l'activité qu'elle suscite s'adresse principalement à des substituts de réalité, images, sons, mots, phantasmes qui ont tôt fait de devenir fantômes [31]. Ne préjugeons rien : peut-être devrons-nous bientôt reconnaître que, transportée dans un autre contexte, la diffusion prend un caractère insoupçonné de vérité. Mais il ne s'agira plus alors de simples multiplications quantitatives.
Somme toute, le trait commun des engins dynamiques, qu'ils soient d'énergie ou d'ordre, a été clairement exprimé par la philosophie bergsonienne, qui conclut la période : ils sont abstraits [32]. Abstraction que l'énergie métamorphosée, arrachée à son lieu naturel et devenue moyen-de-moyen. Abstraction que la répétition et la succession stéréotypées rendues purement numériques par l'effet de l'accélération. Abstraction que l'apprentissage ni vraiment intuitif ni vraiment scientifique, ainsi que les rapports économico-sociaux et urbains qui s'y rattachent. Abstraction que l'information tournant sur elle-même et faisant écran au monde au lieu de le révéler. Bergson ne fait pas explicitement la théorie des machines dynamiques, mais on sent bien qu'elles forment son environnement quand il oppose la quantité à la qualité, le « tout fait » au « se faisant », le déterminisme à la liberté, le temps inerte à la durée vécue. Puisque l'homme, pour régner, a besoin de ces serviteurs qui le réduisent en esclavage [33], il faut à la fois qu'il les promeuve et se reprenne d'eux, cherchant dans le recueillement, un « supplément d'âme ».
Ces analyses, et celles des innombrables essayistes pessimistes qui leur ont fait suite [34], restent vivantes pour nous, car la machine dynamique, comme tout à l'heure la machine statique, est une constante du monde technicien, et son idéal d'efficacité purement quantitative exercera longtemps encore sa fascination sur certains esprits. La seule erreur de Bergson, et surtout de ses successeurs, est d'avoir étendu leur critique d'un état de la machine à la machine en général. Non seulement ils perdaient de vue qu'elle pourrait subir une métamorphose, mais ils oubliaient qu'elle avait connu en ses origines, un état beaucoup moins redoutable. Comment y auraient-ils songé, submergés par les engins nouveaux ?
Si nous montrons plus de prudence, si nous voyons mieux que, avant la Révolution industrielle, les objets techniques avaient un statut très différent et qu'il faut distinguer là deux âges, c'est que nous sommes en train d'en inaugurer un troisième, qui commande directement notre avenir.
1C. LA MACHINE DIALECTIQUE
Nous assistons, de l'avis commun, à une seconde Révolution industrielle. Encore faut-il déterminer au juste en quoi elle réside. On se contente généralement de souligner que les forces nucléaires ont fait faire un bond prodigieux à nos machines d'énergie, que nos machines d'information sont passées du stade encore élémentaire du téléphone à celui des calculatrices et des engins cybernétiques. Et l'on n'a pas de peine à montrer ainsi un énorme accroissement de puissance et de précision : renfort devant l'épuisement des nappes carbonifères et pétrolifères qui avait hanté la conscience du XIXe siècle ; mobilité permettant la mise en valeur des régions désertiques et la décentralisation des autres [35] ; perfection des réglages augmentant les qualités de fini et de proportion que Mumford reconnaissait aux appareils électriques. Mais, si les choses en restaient là, du point de vue culturel qui est le nôtre, serions-nous tellement avancés ? Dans pareille perspective, la technique demeure justiciable de toutes les accusations d'antihumanisme accumulées contre la machine dynamique, suspecte dans ses avantages mêmes.
Par bonheur, elle est le lieu d'une mutation plus profonde. Gilbert Sirnondon a remarqué que tout objet technique est engagé dans un processus de concrétisation, c'est-à-dire que, articulé au départ en fonctions et organes isolés, analytiquement distincts, il tend peu à peu à les conjoindre, à établir entre eux des concomitances, des interrelations, des synergies [36]. Mais alors, il est concevable que certains objets présentent un tel taux d'abstraction qu'ils apparaissent et qu'on les dise abstraits malgré leurs concrétudes, tandis que d'autres présentent un tel taux de concrétude qu'ils apparaissent et soient dits concrets malgré leurs abstractions. C'est par une pareille mutation de taux que nous voudrions caractériser le présent revirement machinique. Tandis que la machine du XIXe siècle, encore analytique, linéaire, juxtaposée, paraissait globalement abstraite, et méritait tous les reproches qui se sont depuis toujours attachés à l'abstraction, la nôtre, dans un nombre sans cesse croissant de cas, découvre assez de synergies pour que la concrétude y passe à l'avant-plan, entraînant une modification profonde de son sens culturel. Il nous semble même qu'avec ce nouveau visage elle explique, ou en tout cas renforce, la plupart des caractères essentiels du monde contemporain ; qu'elle suggère un système de valeurs susceptible de promouvoir un humanisme nouveau.
Ainsi définie, il n'est pas plus facile de dater la seconde Révolution industrielle que la première. Un schème énergétique déjà très concret comme le Diesel remonte à 1893-97 ; un schème cybernétique concret lui aussi comme le feedback s'amorce au XVIIIe siècle, chez Watt. N'oublions pas cependant qu'il y a loin de la première trace d'une découverte technique à son rayonnement culturel. Il faut qu'elle devienne un objet quotidien, en d'autres mots qu'elle s'industrialise. Il importe de plus et surtout qu'elle propose non un simple fait mais un principe avec ses fécondités. Ainsi, dès 1780, Watt dotait sa machine à vapeur d'un régulateur à boules : lorsque la machine tournait à vide, les boules, soulevées par la force centrifuge, agissaient sur un levier interrompant en partie l'admission de la vapeur. Pareil dispositif offre assurément un exemple d'action rétroactive, où un effet (le mouvement du piston) agit sur sa cause (l'admission de la vapeur) pour la régler. Voilà donc déjà le feedback dont nous sommes si fiers ! Mais autre chose est d'inventer un dispositif mettant en œuvre un principe, autre chose de poser ce principe lui-même : Watt n'invente pas le feedback, il invente un mécanisme comportant un feedback. Il faudra attendre 1868 pour que Maxwell en fasse l'analyse rigoureuse ; puis de nombreuses années pour que les physiologistes y reconnaissent clairement une structure de nos montages nerveux ; puis un nouveau temps pour qu'enfin, avec les cybernéticiens contemporains, le feedback prenne la dignité d'un schème universel de fonctionnement. Encore, avant d'appartenir vraiment à l'humanisme, l'invention doit-elle être aperçue par l'homme de culture, qui la transformera en catégorie commune. On voit que le trajet est long. II le reste même quand on brûle certaines étapes : Diesel en créant le moteur à combustion fit tout de suite une invention raisonnée et dégageant son principe [37] ; quelques rares humanistes s'avisent maintenant qu'elle les concerne.
En tenant compte de ces précisions, on peut affirmer que la pensée concrète était en train de poindre au début de ce siècle, lorsque la guerre de 1914 déclencha un gigantesque retour de la plus pure mentalité dynamiste. Ce retour, destructeur pendant le conflit, constructeur en son lendemain, connut la triste retombée que l'on sait dans la grande crise de 1930. Celle-ci montra les impasses du dynamisme pur, et aurait peut-être suffi à promouvoir les préoccupations synergiques mises en veilleuse, comme on le voit dans le technocratisme américain. En tout cas, ces dernières furent portées tout à coup à l'avant-plan par un nouveau conflit mondial, avec ses déblayements brutaux et ses besoins de ripostes instantanées, exigeant les progrès foudroyants du radar, des canons antiaériens, de la recherche opérationnelle. Le monde en prit un nouveau visage qui lui resta dans la paix. En somme, la mentalité concrète se campe définitivement dans la définition de la cybernétique par l'équipe de Norbert Wiener, en 1948 [38], pour les machines d'information, et dans les réflexions précitées de Simondon, en 1958, pour les machines d'énergie.
1C1. La machine dialectique d'énergie
Les concrétudes ou synergies de nos engins s'appliquent à leur ensemble et elles en montrent l'unité. Cependant, comme certaines sont plus apparentes dans les machines d'énergie, d'autres dans les machines d'information, nous les répartirons entre ces deux types pour la commodité.
1C1a. Synergie des fonctions
Le corps d'un avion doit répondre au moins à trois exigences : avoir de la rigidité, offrir une surface convenable de sustentation, fendre l'air facilement. Les appareils du début du siècle prévoyaient à cet effet une carcasse, qui leur conférait la rigidité, et un revêtement, qui leur garantissait la surface de sustentation ; mais cette distinction du revêtement et de la carcasse leur imposait un poids et une forme anguleuse peu compatibles avec la percée de l'air. Dans l'avion actuel, le revêtement est caréné de manière à se faire le plus possible autoportant, - les pressions s'y exercent dans le plan tangent à la courbure moyenne, - si bien qu'il peut diminuer le travail de sa carcasse et parfois même la supprimer. Du même coup, il améliore sa surface de sustentation et facilite sa trouée de l'air, car les formes autoportantes, aérodynamiques, sont idéales à cet égard. Nous sommes donc ici en présence de trois fonctions dont l'une, le revêtement, accomplit en bonne partie les deux autres, la sustentation et la percée. Il faut même préciser qu'en les accomplissant presque seule, et donc en supprimant largement les antagonismes qui ne manquent jamais de surgir entre organes distincts, elle les perfectionne. C'est un cas de plurifonctionnelle simple, que nous appellerons une synergie du premier degré.
Car il en existe de plus complexes. Le cylindre et la culasse d'un moteur à explosion ou à combustion doivent fournir un volume rigide résistant aux pressions intérieures qui s'y exercent ; d'autre part, il leur faut évacuer la chaleur provoquée par ces pressions. Dans les moteurs anciens, les deux fonctions étaient conçues séparément : la rigidité était assurée par l'épaississement du cylindre et de la culasse ; le refroidissement par un courant d'eau froide entraînant la chaleur. Le refroidissement par air est synergique. Le long du cylindre, et spécialement dans la région des soupapes, interviennent les ailettes de refroidissement, qui assurent la dissipation thermique. Or, convenablement réparties, elles garantissent également la rigidité du volume, autrefois obtenue par l'épaississement des parois. Ces ailettes sont donc en même temps des nervures de soutien. Mais en retour, leur travail de nervures permet d'amincir la paroi du cylindre et contribue ainsi à la dissipation thermique, déjà assurée par leur rôle d'ailettes [39]. Comme tantôt le revêtement-carcasse de l'avion, ces ailettes-nervures nous montrent une fonction qui, en s'accomplissant, en accomplit une seconde : c'est leur plurifonctionalité simple, ou synergie du premier degré. Mais en accomplissant cette seconde fonction, elles perfectionnent la première. Nous parlerons alors de plurifonctionalité circulaire, ou de synergie du second degré.
La physiologie de nos machines présente les mêmes schémas que leur anatomie. Dans le moteur à explosion, du siècle dernier, les diverses opérations s'articulent en des moments et des lieux clairement distincts. D'abord le combustible est mélangé à l'air comburant dans le carburateur ; ensuite le mélange ainsi carburé est introduit dans la chambre de combustion ; puis la bougie s'allume sous l'action d'un organe à nouveau distinct, la batterie ; enfin l'allumage de la bougie provoque la déflagration du mélange carburé qui actionne le piston. Dans le moteur à combustion interne de Diesel, qui ouvre le XXe siècle, ces moments et ces lieux se conjuguent. C'est en effet l'injection du combustible dans l'air comprimé par le retour du piston qui à la fois le mélange à l'air (rôle de carburateur), l'enflamme (rôle de bougie) et repousse le piston (rôle moteur de la déflagration). Voilà des synergies du premier degré. Mais on en dépisterait du second. Alors que dans le moteur à explosion il y a antagonisme marqué entre la compression et la déflagration, puisque celle-ci sous l'effet de la pression risque de se transformer en détonation, dans le Diesel, la compression étant la source de la déflagration réduit l'antagonisme entre elle et son effet qui la provoque en retour ; elle pourra s'augmenter en l'augmentant.
ÉCHAPPEMENT ADMISSION
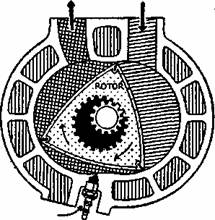 BOUGIE |
Notons que le progrès de la concrétude n'est pas toujours rectiligne. Dans le récent moteur Wankel, certaines synergies du Diesel sont abandonnées : on en revient à l'allumage par bougie et à la carburation préalable, pour gagner par ailleurs. Il restait en effet un antagonisme entre les propriétés des moteurs à piston et celles des turbines. Les premiers fonctionnent économiquement à l'essence, dont le transport aisé convient bien à l'automobile, mais par contre connaissent schéma du moteur Wankel toutes les pertes d'énergie inhérentes à l'aller et retour brutal du piston avec son double freinage ; les turbines, elles, ne présentent pas ces inconvénients, mais dans les unités réduites elles ne fonctionnent économiquement qu'à l'eau ou à la vapeur, ce qui, jusqu'à nouvel ordre, les rend impropres à l'automobile. Wankel [40] a imaginé un rotor triangulaire enfermé dans un cylindre aplati. Les trois chambres ainsi créées entre le rotor et le cylindre servent la première à l'admission et à la compression initiale du mélange carburé, la seconde à sa compression maximale et à son explosion, la troisième à sa détente et à son évacuation. La révolution du rotor, provoquée par la déflagration, à la fois entraîne le mélange carburé, le comprime, accélère son échappement après son temps moteur ; de plus, elle meut directement l'arbre qui est l'âme de l'engrenage fixe sur lequel se meut le rotor. Ainsi Wankel a conçu une configuration du piston qui rend simultanées et réconcilie les fonctions jadis antagonistes de compression et d'expansion motrice, et les conjoint toutes deux avec une troisième fonction jadis incompatible, la rotation directe d'un arbre.
Le moteur Wankel montre d'ailleurs fort bien qu'il est artificiel de considérer séparément l'anatomie et la physiologie de nos engins, car elles sont souvent en synergie entre elles. Le moteur d'avion classique, en faisant tourner l'hélice, propulsait l'appareil, mais son corps devait vaincre en pure perte la résistance de l'air : les deux fonctions de propulsion (physiologique) et de trouée (anatomique) étaient antagonistes ; le statoréacteur les concilie : c'est la pression de l'air à l'entrée du divergent qui assure, par compression, la combustion du kérosène, dont les gaz en s'échappant du convergent entraînent l'effet propulsif.
Il serait loisible d'allonger la liste de tous ces exemples, en particulier dans les machines électriques où, initialement, on ne pouvait prendre assez de précautions pour isoler les uns des autres les organes, de peur que leurs champs ne se perturbent. La machine électrique ou électronique contemporaine, au lieu d'isoler les champs, tente de les conjuguer dans une action unique, et Simondon a montré les synergies de toutes sortes que propose, dans la production des rayons X, le passage du tube de Crookes au tube de Coolidge, ou dans les engins d'amplification, celui de la diode de Fleming à la triode de Lee de Forest, puis à la tétrode et la penthode [41].
Pour l'instant, nous nous en tenons à une simple description, et ce n'est pas le lieu de souligner la portée culturelle de tout ceci. Mais si l'on se rappelle que le grand désarroi causé par la machine, à l'ère dynamique, provenait de son opposition à la vie, on devine la portée d'une transformation qui, en lui faisant réconcilier sous forme de concours ce qu'elle avait jusqu'ici séparé, lui donne divers caractères précisément de l'être vivant, tout rempli de synergies du premier et du second degré. Cette parenté par le fonctionnement va beaucoup plus loin que la simple assimilation par des apparences « rappelant » la vie, où Mumford voyait déjà un progrès sensible en 1934. Il y a désormais, de part et d'autre, une idée organique, une prévalence du tout sur la partie, où la partie cesse d'être un rouage pour devenir un organe.
1C1b. Synergie de la machine et de la nature
De même qu'elle isolait ses fonctions pour les réaliser avec plus de pureté, la machine du siècle passé s'appliquait à la nature ambiante du dehors : elle la transformait en évitant la transformation en retour. La locomotive ancienne fonçait devant soi, subissait la résistance de l'air en pure perte, à son corps défendant. Les hélices d'avion, pour propulser l'appareil, déterminaient une accélération de l'air en aval qui était gaspillée en turbulence.
Nos voitures rapides utilisent toujours mieux la résistance de l'air pour augmenter leur tenue de route. Dans un récent modèle d'avion, le Bréguet 941, un léger recouvrement des hélices synchrones permet de diriger uniformément sur les ailes le débit de l'air accéléré de manière à augmenter la portance. En ces deux cas, une première fonction de la machine (la propulsion) provoque une réaction du milieu qui, loin d'être nuisible ou vaine comme autrefois, favorise en retour une autre fonction (l'adhérence ou la sustentation). La synergie positive joue non plus seulement entre les organes ou fonctions machiniques mais entre la machine et son milieu.
Du reste, on voit en cet ordre des synergies qu'on pourrait dire négatives. Grâce à de nombreuses plurifonctionalités [42], la génératrice Guimbal peut être immergée tout entière avec sa turbine dans la conduite forcée du mur de barrage. Or là, si le flux liquide s'accélère, il accélère les hélices de la turbine, ce qui a pour effet d'échauffer celle-ci, mais en même temps d'augmenter sa turbulence à lui, ce qui facilite l'évacuation de la chaleur. L'écoulement de l'eau est donc pris dans un dispositif où il est à la fois principe de chaleur et de refroidissement. Il ne s'agit donc plus d'une action qui en augmente une autre pour s'accroître elle-même. Le problème est moins d'accroissement que de réglage. La machine et le milieu sont en causalité circulaire de régulation.
Nous voilà loin du viol dynamiste sans revenir au simple prolongement des forces naturelles propre à la machine statique. Une réconciliation s'opère, mais active, à base de causalités réciproques, et qui fait naître ce que Simondon appelle un « milieu associé » [43]. L'eau autour de la turbine Guimbal, l'air autour du bolide ou entre l'hélice et l'aile du Bréguet 941 ne sont pas machine ; ils ne sont pas non plus simple nature ; ils forment avec la machine une réalité médiane. Ce type de réalité n'aura qu'à prendre plus d'ampleur, à devenir plus spectaculaire - et nous en verrons bientôt des exemples - pour que son incidence culturelle, l'estompement de l'ancienne Nature immuable, saute aux yeux.
1C1c. Synergie de la matière et de la forme
Lorsque Aristote distinguait dans tout être fini une « matière » et une « forme », il s'inspirait des objets techniques qu'il voyait à ses côtés. N'importe quel outil ou machine d'autrefois résultait d'une configuration imprimée dans un matériau. Qu'il s'agisse d'une poulie antique ou d'une locomotive à vapeur du siècle dernier, on retrouvait partout une structure et un réceptacle, et entre eux la séparation propre à la technique abstraite [44].
Devant nos thermomètres ou nos transistors à germanium, il devient impossible de considérer le germanium comme ce dans quoi s'incarne la forme de l'instrument ; il est lui-même, par l'intime de sa structure électronique, ce qu'il y a de plus original dans la forme. Semblablement, le tungstène dans l'anticathode d'un tube de Coolidge n'est pas seulement disposé de manière à permettre l'apparition des rayons X ; c'est son nombre atomique élevé en même temps que sa haute résistance à la fusion qui constitue à la fois l'étoffe de l'appareil et son idée. Dans nos engins électroniques et a fortiori dans ceux qui mettent en œuvre l'énergie nucléaire [45], le « matériel » et le « formel » se conjuguent et vont jusqu'à échanger leurs rôles.
Qu'on applique la même observation à cette autre matière d'une machine qu'est son combustible. La forme de la locomotive d'autrefois se contentait d'utiliser de la chaleur d'où qu'elle vienne, suivant l'extériorité de l'abstraction ; aussi, elle brûlait n'importe quoi et ne choisissait d'ordinaire le charbon que par commodité. Nos moteurs rapides au contraire brûlent leur combustible en introduisant ce qu'il a de plus particulier dans le plus particulier de leur structure ; et ils sont devenus très exclusifs dans leur choix, selon les exigences de la concrétude [46].
Peut-on dire qu'en tous ces exemples matière et forme sont en synergie ? Assurément, et nous avons peut-être trop vite avancé qu'elles s'incorporaient et fusionnaient. En réalité, elles figurent des pôles de tension distincts dans la mesure où la matière cesse d'être une pure passivité, pour prendre elle-même, dans sa trame, une originalité machinique. Mais du coup elles se fécondent l'une l'autre : la fonction de la forme s'accomplit d'autant mieux qu'elle assigne un travail quasi formel à la matière, et réciproquement ; nous retrouvons nos synergies positives du second degré. Et comme ces interactions, dans une pile atomique par exemple, sont aussi bien régulatrices que stimulatrices, revoici nos synergies négatives.
A nouveau, ce n'est pas le lieu de passer déjà aux conséquences humanistes. Mais étant donné l'influence qu'eut la distinction de la matière et de la forme dans la philosophie et jusque dans la rhétorique anciennes, étant donné son rôle dans la conception de la nature comme substrat permanent, et de l'homme comme simple modeleur des choses, on entrevoit une fois de plus la transformation culturelle impliquée dans les nouveaux schémas moteurs.
Ce trop bref survol des synergies énergétiques montre assez où réside leur intérêt. Elles ne nous promettent pas nécessairement une diminution des organes : ceux-ci dans un Diesel ou une triode sont plus nombreux que dans les machines plus abstraites correspondantes. Elles ne nous promettent pas davantage que les machines seront plus faciles à comprendre, ni plus commodes à réparer, ni même plus polyvalentes ; la machine abstraite, dans la mesure où elle séparait les fonctions, se prêtait bien à l'explication, était aisément réparable et se montrait apte à des rôles très divers. Mais la machine concrète introduit un monde nouveau qui dans son ensemble est plus puissant et plus souple que l'ancien.
Du point de vue qui nous occupe, elle entraîne surtout une nouvelle mentalité. Sans doute restera-t-il toujours un grand nombre, voire une majorité d'outils et de machines statiques (il n'y a pas de monde technique sans marteau et sans treuil) ou dynamiques (on continuera de juxtaposer les fonctions pour des raisons d'économie, de commodité ou de prestige, comme il se voit dans les accessoires automobiles). Sans doute aussi n'y a-t-il pas de rupture entre les machines plus abstraites du XIXe siècle et nos machines plus concrètes, et l'intention technique a toujours comporté une tendance à la concrétisation. Sans doute encore, aujourd'hui comme autrefois, chaque série machinique qui s'inaugure doit-elle repasser par des stades très abstraits, très analytiques, comme le prouvent assez les présentes recherches d'un moteur nucléaire. Mais il n'empêche que globalement le monde technique contemporain offre un nouveau visage. De plus en plus d'objets y montrent une concrétude assez frappante pour que le technicien l'aperçoive comme telle, qu'il la poursuive de façon explicite, que là même où il doit repasser par des stades abstraits, comme dans les nouvelles séries, il sache que c'est à elle qu'il tend : c'est pourquoi il l'atteint si vite.
Et comme nous venons de voir que la synergie prise dans toute son extension est synonyme de rapports organiques entre les parties machiniques, qu'elle suggère des rapports dialectiques entre machine et nature, matière et forme, on ne sera pas étonné que la machine récente introduise une nouvelle vue technique [47] et culturelle des choses, en tout cas qu'elle la favorise. Nous allons le vérifier dans nos machines d'information.
1C2. La machine dialectique d'information
Ne nous attardons pas aux machines de transmission - téléphone, radio, télévision - qui, en ce qui concerne leur aspect informationnel, visent seulement à multiplier ou à diffuser des messages : leur signification dynamiste ou dialectique dépend du genre de réseau dans lequel elles sont insérées. Il y a moins à dire encore de certaines machines à calculer, les machines arithmétiques électrifiées, qui ne font qu'ajouter des commandes nouvelles à des mécanismes dont le principe remonte à Pascal.
Mais, parmi nos machines à calculer, certaines, plus originales, permettent non seulement d'effectuer des calculs mais de résoudre des problèmes. Les machines analogiques sont des dispositifs mimant les données par des relations entre forces physiques : par exemple, les tensions et les résistances d'un circuit sont adaptées de manière à représenter une équation, dont l'intensité du courant lue sur un ampèremètre fournit le résultat. On le voit, le processus, au lieu d'être simplement linéaire comme dans les machines arithmétiques, exploite une structure totale. Mais plus remarquables encore semblent les ordinateurs, capables d'atteindre leurs solutions complexes numériquement, c'est-à-dire à travers une succession de quantités discrètes exactement déterminables. Ces machines logiques [48] s'adaptent à la situation, confrontent les résultats partiels obtenus avec leurs instructions, essayent une voie, l'abandonnent si elle s'avère infructueuse, en choisissent une autre plus probable d'après les résultats antérieurs qu'elles ont entre-temps extrapolés ou interpolés en une sorte d'induction ; elles peuvent en effet contenir des machines à induire statistiquement des moyennes, à établir des corrélations, à dégager des lois de séries, qu'ensuite elles interpolent et extrapolent. Là donc où les machines analogiques exploitaient une structure globale mais d'une manière encore massive, - statique ou dynamiste, comme on veut, - la machine logique, grâce à ses mémoires permanentes et transitoires (cartes perforées, rubans magnétiques, tubes à ondes entretenues), interconnecte également toutes les parties de son système, mais d'une manière vraiment circulaire et déjà dialectique, dont n'est pas exclu le retour rectifiant au passé.
Nos machines à comportement vont jusqu'au bout sur ce chemin. Non contentes d'élaborer des informations reçues et restituées passivement, elles conjoignent à leurs organes logiques, qui élaborent les informations pour en déduire une directive appropriée, des organes énergétiques d'exécution et d'exploration, qui leur permettent de réaliser elles-mêmes les tâches et d'aller en recueillir les données en un circuit d'actions et de réactions où l'on retrouve trois des formes synergiques d'insertion d'un vivant dans son milieu. En effet, le vivant doit assurer son équilibre interne quelles que soient les informations (plus ou moins perturbatrices) reçues du dehors ; il lui faut explorer son environnement à la recherche d'informations nouvelles ; il doit même être capable d'apprendre, c'est-à-dire de dégager parmi les informations qui l'assaillent celles qui seraient pour lui significatives : le conditionnement pavlovien est cette opération complexe par laquelle un animal distingue au milieu d'innombrables stimuli neutres ceux qui annoncent ses stimuli spécifiques (tels la proie ou le partenaire sexuel), et retient leur valeur de signal. Or l'homéostat d'Ashby, appelé pittoresquement par Grey Walter Machina sopora, est un appareil composé de quatre galvanomètres à aimant mobile interconnectés de telle façon [49] que, si l'expérimentateur perturbe l'un des éléments (par exemple, en bloquant son aiguille), les autres retrouvent l'équilibre du fait que leur feedback principal est, selon les nécessités, libéré ou contrarié par des feedback secondaires, qui d'ailleurs s'entrecomposent à leur tour si l'un d'entre eux vient à défaillir : l'appareil est donc homéostatique à l'égard de son milieu, représenté en l'occurrence par l'expérimentateur malveillant. Machina speculatrix, munie d'une cellule photoélectrique couplée à un tropisme positif, et d'un contact électrique couplé à un tropisme négatif, combine si bien les données ainsi reçues qu'elle engage une exploration approfondie de son espace vital, contourne certains obstacles et déplace les autres, cherche les « conditions de vie » optimales (moyennes), va se recharger en cas de besoin, adopte un comportement différencié vis-à-vis de ses congénères, comme aussi de sa propre image dans un miroir. Quant à Machina docilis, grâce à ses mécanismes d'exploration (scanning), à des seuils de perception et de mémoire qui ne saisissent et ne retiennent que les stimuli neutres effectivement liés aux stimuli spécifiques, elle est capable de dégager dans son entourage des « significations » et de se modifier et de le modifier en conséquence. Les circularités que la machine logique réalisait à l'intérieur d'elle-même, les machines à comportement les étendent à leur milieu.
Nous n'avons pas à décider s'il faut appliquer l'épithète de cybernétique à toutes ces machines sans distinction, identifiant cybernétique et théorie de l'information, ou s'il convient de réserver le terme aux seules machines de comportement. Nous n'avons pas à décider non plus si, parmi ces dernières, l'avenir lointain appartient plutôt aux servo-mécanismes que leur programmation (taping) prédispose aux tâches de contrôle, ainsi que l'envisage Wiener [50], ou, au contraire, à ces machines à comportement inventif, qui ont stimulé la réflexion de Grey Walter [51]. Enfin, nous n'avons pas à trancher si les propriétés de ces engins épuisent ce qu'il y a de concret dans le comportement vivant, ni même si tout apprentissage, comme le veut Grey Walter après Pavlov, est de nature associative [52]. Toutes ces précisions, délicates et importantes en soi, dépassent notre propos.
Mais telles que nous venons de les décrire, et certaines dussent-elles présenter un intérêt plus spéculatif que pratique, nos machines d'information témoignent des mêmes synergies entre organes et entre fonctions, entre machine et nature, entre matière et forme, que nos machines énergétiques : Machina docilis à elle seule en montre de négatives et de positives, du premier et du second degré. C'est pourquoi elles se distinguent moins par le nombre de leurs éléments que par la richesse de leurs interconnexions [53] ; elles sont le lieu de blocages par conflits informationnels, de déblocages par repos ou par secousses réorganisatrices ; leur action présente des « degrés de liberté » en ce sens qu'elles peuvent accomplir un comportement prévu selon des voies diverses, et parfois même manifester des types de comportement imprévus ou ignorés de leur constructeur. Pour les synergies que nous avons reconnues jusqu'ici, une seule nuance sépare machines énergétiques et machines d'information : les premières illustrent peut-être mieux l'intimité du fonctionnement, les secondes l'homéostasie et la créativité du comportement, - la conjonction des deux aspects restant, jusqu'à nouvel ordre, ce qui distingue le vivant de la machine [54].
On peut dire que, comme le XIXe siècle a inventé l'énergie, le nôtre a inventé l'information. Elle aussi était vieille comme le monde, elle était là depuis qu'un animal en avait ébranlé un autre par un signe, depuis qu'un mécanisme quelconque en avait « commandé » un autre par une transmission ; bien plus, grâce au télégraphe, au téléphone, elle avait pris une importance si considérable au XIXe siècle que le temps était devenu toujours davantage une quatrième dimension du monde machinique. Mais jamais avant les années où s'est définie la cybernétique, et malgré l'utilisation du régulateur par Watt et son analyse par Maxwell, on n'avait clairement aperçu l'originalité des modèles temporels : la possibilité de l'action en retour, où l'effet agit sur la cause, soit pour la modérer dans l'homéostasie, soit pour confronter significativement un présent avec un passé dans la créativité de l'apprentissage. Somme toute, avec l’« information en retour », - les Allemands traduisent feedback par Rückmeldung, - le machinisme a joint la synergie dans le temps à la synergie dans l'espace.
Et comme toujours, le cas extrême a fait prendre conscience d'une catégorie encore mal dégagée : la découverte explicite de l'information en retour a conduit à celle de l'information en général. Aux environs de la Seconde Guerre mondiale, ingénieurs, physiologistes, psychologues, sociologues se rendirent compte qu'avec ou sans feedback elle formait une réalité universelle dont les lois communes reliaient la machine, le vivant, la culture, le milieu [55]. En même temps cette découverte de l'information en général engendrait celle de l'ordre comme réalité complémentaire mais distincte de l'énergie [56]. Une fois encore on aperçoit les conséquences humanistes. La machine cesse d'appartenir au domaine de la force brute, pour manifester une réalité déjà spirituelle et culturelle : la synergie non seulement dans l'espace mais dans le temps.
Cependant nous nous étions promis davantage que des applications des synergies envisagées plus haut et même que leur extension au temps. Nous avions annoncé que nos machines d'information nous proposeraient des synergies nouvelles qui, sans leur être limitées, s'y illustreraient plus clairement.
1C2a. Synergie de la machine et de la machine
A première vue, la machine concrète accentue le caractère d'indépendance qui effrayait déjà Butler dans ses ancêtres abstraits. L'intimité des échanges d'énergie jointe aux capacités d'autorégulation et d'initiative lui permet toujours mieux de se suffire. Une fusée sous-marine, avec sa réserve nucléaire à long terme, son pilotage chercheur automatique et les riches plurifonctionalités de sa structure externe et interne, résume au mieux cette autarcie qu'on a caractérisée du mot magique d'automation, L'avenir de la machine serait donc le robot, aboutissement de l'automate du XVIIIe siècle, d'autant plus fascinant et inquiétant, plus sacré, qu'il se referme davantage sur soi ?
Mais ce rappel du XVIIIe siècle nous avertit de notre erreur. Les joueurs de clavecin mécanique des horlogers suisses, le canard de Vaucanson mangeant, digérant, excrétant, manifestaient un besoin de jeu et d'exhibition foraine (on ne dira jamais assez le ludisme de la mécanique ancienne, qui culmine chez Vinci), quand ils ne visaient pas inconsciemment des buts prométhéens et démiurgiques (qu'on songe au côté faustien du même Léonard) [57] ; et il fallut qu'un ministre des finances s'avise de nommer Vaucanson inspecteur des manufactures de soie, pour qu'il invente (1741) la machine à tisser que perfectionna Jacquard. La technique concrète d'aujourd'hui est toute différente. Elle ne cherche nullement le jeu et la performance, et pour autant elle ne vise pas à illustrer ses machines par l'indépendance comme telle, au contraire.
En effet, la concrétude tend par définition à englober des ensembles toujours plus vastes. Elle ne trouve son accomplissement énergétique qu'en débordant les organes internes d'une machine et même son milieu associé pour les annexer à d'autres qui les prolongent en un milieu associé machinique ; au point de vue informationnel, elle est d'autant plus synergique qu'elle ouvre sur des circuits plus nombreux et plus variés. C'est pourquoi les modèles significatifs de l'automation actuelle ne sont pas les robots de foire, travailleurs isolés, mais ces usines électriques de Russie ou d'Amérique où les engins les plus divers se nouent en d'infinis rapports d'énergie et d'information, jusqu'aux confins d'unités si vastes qu'elles incluent le paysage et le système routier. Plus que l'autarcie, l'idéal de nos machines est la polyvalence, la possibilité d'inclusion dans des situations machiniques très diverses.
Ceci, du reste, n'est pas sans poser un délicat problème. Les synergies d'inclusion supposent que la machine demeure un système ouvert, non saturé ; mais ses synergies internes tendent à la rendre indépendante, à en faire un système saturé. La machine actuelle ne peut donc pas être polyvalente au sens de l'outil ancien, par simple indifférenciation [58] ; il faut que son ouverture tienne à sa distinction même : telles ces machines numériques hautement spécifiées qui, selon leur codage, réalisent des extractions de racines cubiques ou des traductions de langues. Bref, on ne peut dire absolument de nos engins ni qu'ils se ferment ni qu'ils s'ouvrent. Dans la mesure où ils s'accomplissent, ils se ferment pour se rendre branchables, et leurs synergies d'indépendance ont pour but d'enrichir leurs synergies d'inclusion. Même le satellite artificiel n'a pas pour fin ultime de voguer seul le plus longtemps et le plus loin mais, malgré la distance, de rester en contact avec sa base, et en définitive d'être récupérable, - la récupération fermant le circuit concret, et l'opposant aux linéarités abstraites du dynamisme. En un mot, le concept technique fondamental n'est plus la machine mais le réseau [59], ensemble synergique de machines synergiques.
Le réseau ainsi entendu offre une physionomie tout autre que celle des établissements techniques antérieurs, en particulier en ce qui concerne la circulation des informations. Durant l'ère de la machine statique, les équipements puisaient, transformaient, restituaient leur information quasi sur place ; les postes de direction (par exemple, le pouvoir politique de Rome sous l'Empire) se contentaient d'assurer à l'ensemble certaines conditions générales (monnaie, route, sécurité) permettant aux établissements particuliers de fonctionner ; et il y avait peu à se préoccuper de coordination. Au contraire, la coordination devint indispensable à la machine dynamiste, à cause de ses nécessaires concentrations d'énergie, et c'est à travers la centralisation des ressources, mais aussi des informations, qu'elle l'obtint. Le réseau synergique est à cet égard dans une situation ambiguë. D'un point de vue, on dirait qu'il exige d'être centralisé : car tout y dépend tellement de tout que les décisions supérieures supposent la confrontation du maximum d'informations en un seul point [60]. Mais, en même temps, les centres secondaires y ont une telle originalité qu'il importe de leur laisser définir entre eux des constellations partielles en tous ordres. En sorte que le pouvoir central, - si on peut l'appeler ainsi, - plutôt que d'être le foyer de collecte et d'émission de l'information (et de la décision), joue un rôle nouveau, celui de facilitateur (d'activeur) d'interconnexions [61]. Nous retrouvons les analogies avec la vie. Mais nous pressentons surtout les transformations culturelles, sociales, politiques, que ce passage d'un schéma pyramidal (dynamiste) à un schéma plurinodal (réticulaire) va exiger [62].
1C2b. Synergie de la machine et de l'homme
La question ressurgit cependant. Car si la machine concrète s'ouvre au réseau, n'est-ce pas celui-ci qui se referme, évacuant l'homme ? Tout au contraire, le réseau dialectique comporte une dernière synergie, et précisément avec l'être humain.
On songe au human engineering, cette discipline relevant à la fois de l'ingénieur et du psychologue, qui a pour but, à partir d'une étude approfondie de notre organisme et de l'objet technique, de déterminer quelles structures doit présenter la machine et à quel apprentissage doit se soumettre l'homme pour que leur couplage ait son plus grand rendement. Cette étude remonte à la préhistoire puisque tous les outils ont deux faces, l'une tournée vers la nature, l'autre vers l'ouvrier ; Taylor lui a fait faire le progrès qu'on sait, attirant sur elle l'attention du grand public ; mais elle n'a pris son importance décisive qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les appareils de contrôle ultra-rapides (radars et postes de pilotage) exigèrent des adaptations très raffinées [63]. Cependant, le human engineering ne prouve pas que la technique s'humanise. Sans doute ses théoriciens ont-ils été conduits à faire une part toujours plus large à ce qu'il y a d'humain dans le rendement technique, et l'on a vu Taylor, parti de la coercition, passer à raffinement gymnastique du geste, pour découvrir enfin que le travail le plus stéréotypé présuppose des satisfactions d'ambiance, de contemplation, de considération, d'ouverture, de joie [64]. Mais ces recherches concernent l'humain en fonction d'autre chose. Si l'on en restait là, il s'aliénerait.
Aussi, pour saisir le véritable couplage de l'homme avec l'objet technique, faut-il plutôt les comparer et voir comment la machine concrète, dans la mesure même où elle se rapproche de l'homme, détermine et lui fait cultiver sa différence [65]. La machine enregistre davantage, plus vite, plus fidèlement (elle a même tendance à enregistrer trop, comme le savent les ingénieurs des communications en lutte incessante contre les bruits de fond) ; mais si peu intelligent soit-il, l'auditeur d'une conférence en tire plus d'associations créatrices qu'un dictaphone, plus qu'une machine logique, plus même qu'une machine de comportement. Celle-ci, bien que douée de degrés de liberté et parfois de types d'associations imprévus de son constructeur, se montre beaucoup moins inventive que le cerveau, capable, selon l'expression de Grey Walter, d'établir des rapports significatifs « entre à peu près n'importe quoi et n'importe quoi », capable surtout, en vertu de l'intimité cellulaire de ses processus, d'une prise de conscience où son activité n'est plus seulement « encadrée » comme celle de la machine, mais « encadrante » [66]. Bref, si la machine cybernétique qui explore un secteur du réel avec une vitesse et une justesse surhumaines (le tube électronique travaille mille fois plus vite que le neurone) est maîtresse dans l'ordre des réponses à des questions d'un type quasi prévu, le cerveau garde la maîtrise dans l'ordre de l'interrogation, du projet, de la réponse aux questions de type imprévu [67].
C'est ce qui fait sa rentabilité dans les menues besognes. Les machines cybernétiques de contrôle rendront d'immenses services pour les manipulations de grand volume : chaînes de montage d'automobiles, usines d'électricité ; elles ne remplaceront ni l'épousseteuse, ni l'épicier, ni le garagiste, ni tous les ouvriers chargés de travaux restreints, très différenciés, et épisodiques. La machine à cueillir des oranges, constructible, ne serait pas rentable. On peut confesser, avec Wiener, que le terrassier qui suit le bulldozer pour gratter les coins est le glaneur de la machine ; mais il faut être une machine plus complexe pour glaner que pour moissonner. Seul le cerveau humain, et éventuellement le cerveau animal [68], sont assez plastiques pour réaliser économiquement ces menues adaptations.
Et pour les plus exigeantes, que postulent précisément les techniques nouvelles et où l'animal ainsi que l'homme animalisé sont mis hors jeu, c'est le cerveau humain dans ce qu'il a de plus distinct qui est requis. En effet, le réseau auquel nous tendons, du fait même qu'il se présente comme un tissu d'interrelations spatio-temporelles prodigieusement complexes et fécondes mais aussi fragiles, où la moindre faille entraîne des déviations à long terme, suppose, pour seulement se maintenir, la continuelle vigilance de l'esprit. Mais surtout, comme l'a marqué Simondon, sa concrétude l'entraîne dans un incessant processus de concrétisation qui, en raison même de la synergie, ne peut avoir lieu que par des réorganisations globales de tous ses éléments, c'est-à-dire dans une invention véritable : plus l'objet est concret, moins il peut évoluer par des perfectionnements de détail, et il suppose, à chaque progrès majeur, une refonte du système entier [69]. Ainsi, le réseau concret, tant dans son existence que dans sa genèse, forme avec le cerveau humain un couple où celui-ci est concerné dans ce qu'il a de propre : sa capacité interrogative et initiatrice. Ce couple dessine de toute évidence des synergies non seulement du premier mais du second degré, où chacun des termes en perfectionnant l'autre se perfectionne lui-même.
* * *
Dans tout le cours de ce chapitre, à de rares exceptions près, nous nous sommes limités aux machines. était-ce légitime si nous avions l'ambition d'embrasser les étapes de la technique en général ? Mumford remarquait que les machines sont une partie assez modeste du monde technique, qui comprend encore les outils (la pince), machines-outils (le tour), ustensiles (les récipients), appareils (le four), véhicules (les charrettes, navires, avions), utilités (les routes, canaux, écluses, aqueducs), et même, par-delà ces objets étendus dans l'espace, les procédés, qui se développent dans le temps : cuisine, tannage, foulage, tissage, teinture, élevage, domestication, jusqu'à la synthèse des plastiques ou des acides aminés, sans compter les actuelles réactions électroniques et nucléaires. Tout cela, à quoi il faut joindre les transformations du paysage introduites par l'agriculture et les communications, ainsi que les manipulations monétaires, l'organisation politique ou éducative, appartient à la technique ; tout cela exerce une influence culturelle incontestable. Mais Marx n'avait pas tort de croire que les machines sont ici l'élément le plus frappant et le plus symptomatique, au moins depuis le XIXe siècle. Mumford lui-même semble le reconnaître quand il adopte la convention de parler des machines au sens propre, et de désigner comme la machine le monde technique en général.
Et, en effet, la division tripartite que nous a suggérée le domaine proprement machinique se retrouve si clairement dans toutes les autres formes de technique qu'il serait fastidieux d'y insister. N'en prenons pour preuve que l'évolution du rendement. En tous ordres, l'ère statique, en continuité avec la nature, cherchait à produire des énergies réduites mais sans déchets : l'artisan excelle à utiliser le moindre copeau, et rien n'est plus net, plus économiquement coquet, que la mise en œuvre hydraulique et éolienne du paysage hollandais du XVIIe siècle. Au contraire l'ère dynamique, obsédée par les quantités produites, ne donna qu'une attention médiocre aux quantités gâchées ; il lui arrive même de s'en vanter, car elles symbolisent la puissance : bruits, fumées et terrils sont aussi flatteurs pour un site minier paléotechnique que ses puits d'extraction. L'ère concrète, toute préoccupée de retour, s'évertue partout, et en particulier dans ses combustibles, à remplacer le schéma matière brute = produit + déchet par le schéma matière brute = sous-produit + sous-produit [70] ; elle y est même contrainte dans le cas de l'énergie atomique, dont les résidus sont violemment nocifs. La récupération, la synergie des actions simultanées et des actions successives, sont donc aussi sensibles dans nos processus chimiques que dans les machines au sens strict.
Elles le sont autant en économie politique, où l'on s'éloigne du simple activisme de naguère. L'industrialisation d'une région nous apparaît comme tout autre chose qu'un rassemblement de capitaux, une standardisation de procédés, un acheminement de matières premières bon marché et l'envoi d'excellents techniciens. Ici encore le réseau concret comprend non seulement les ressources naturelles d'un pays, ses voies de communication et son potentiel humain brut, mais son organisation sociale, le « tonus » psychologique de sa main d'œuvre avec ses besoins de stabilité et d'évasion, le tout en causalité circulaire, en sorte que l'invention économique, comme tantôt l'invention machinique, consiste non en perfectionnements quantitatifs et locaux, mais en la création de formes globales où tous les facteurs se réorganisent en transformant leurs causalités réciproques [71]. C'est pourquoi l'économie contemporaine se situe au-delà de la centralisation de type dynamiste et de la décentralisation de type artisanal. Ses concepts de base ne sont plus la concentration ou la dispersion, mais l'interdépendance [72], l'intégration, la complémentarité, la régulation interne, la mobilité réorganisatrice. Par là sont disqualifiés non seulement le corporatisme de l'ère statique, mais l'alternative paléotechnique du libéralisme et du dirigisme. Par les structures concrètes qui les sous-tendent, et dans la mesure où elles sont plus développées, nos sociétés capitalistes apparaissent acculées à un libéralisme de plus en plus planifié, comme nos sociétés socialistes à un dirigisme de plus en plus ouvert. Nous n'avons pas ici à décider de l'avenir de ces deux systèmes, mais, pour autant qu'ils s'avèrent viables, ils ne seront pas un simple compromis, un juste milieu entre centralisation et décentralisation, mais une réalité originale, répondant à un nouveau concept, celui d'économie synergique, ne privilégiant ni le centre ni les extrémités mais les incluant dans des interactions.
Et comme les mêmes schèmes de pensée se dépistent dans nos plannings médicaux, voire dans nos campagnes d'opinion, - d'ailleurs tout imprégnées encore d'énergétisme abstrait, - c'est donc bien la technique dans son ensemble qui a parcouru trois états : statique, dynamique, dialectique.
Chapitre 2 - LES SUGGESTIONS HUMANISTES DE LA MACHINE DIALECTIQUE
La machine dynamique nous aura appris qu'on ne peut pas se contenter d'arguments trop faciles pour justifier culturellement une technique. Point ne suffit d'alléguer son pouvoir de diffuser les idées, de faciliter le travail, d'augmenter les loisirs, de supprimer la rareté. Tout cela, qui a son prix, en fait un moyen de la culture, alors que celle-ci, d'essence créatrice, est toujours compromise autant qu'aidée par toute espèce de moyen. De simples instruments de diffusion et de facilité peuvent contribuer à entretenir un passé moribond.
Mais reste à voir si la technique actuelle outre un moyen n'est pas elle-même, dans sa structure, dans ses modes d'être et de paraître, une réalité culturelle, chargée de valeurs susceptibles d'un nouveau départ. Quelles exigences devrait-elle remplir à cet effet, sinon les trois conditions de tout principe d'humanisme : dévoiler un aspect fondamental de la nature ; engager une conception neuve et essentielle de l'esprit ; impliquer une restructuration motrice de la société ?
2A. LA NATURE ARTIFICIELLE
Les humanismes anciens étaient partout soutenus par l'idée de nature, de naturel, de nature des choses. C'est trop clair pour la Grèce et l'Europe d'après la Renaissance, mais il en alla semblablement à toutes les époques et sous toutes les latitudes. Si le Médiéval, le Byzantin, l'égyptien, le Chinois, l'Indien, l'Africain n'ont pas le même souci que le Grec et le Renaissant de reproduire les formes extérieures et d'étudier les rapports quantitatifs, ce n'est pas qu'ils méprisent la nature, mais qu'ils la conçoivent d'autre manière : les icônes byzantines manifestent la Transcendance parce que celle-ci pour l'orthodoxe est la vraie naturalité. Ainsi, en s'entendant sur les mots, les humanismes d'autrefois furent tous réalistes. A leurs yeux, vérité, bonté, beauté sont là devant l'homme, avant l'homme, qui n'a qu'à les reconnaître. Elles peuvent être conçues très différemment par l'empirisme aristotélicien, qui les poursuit dans les faits sensibles, ou par le rationalisme platonicien ou cartésien, qui les voit dans un monde d'idées spirituelles ; elles peuvent être immanentes ou transcendantes : n'importe. Le fait et l'idée ont en commun d'être donnés, de devoir être reconnus. D'où la sécurité de l'homme traditionnel : immobiliste comme Parménide ou mobiliste comme Héraclite, il se repère et s'assure dans un ordre préétabli [73].
La mentalité idéaliste, qui se fait jour dans le courant du XVIIIe siècle, marque la première faille dans ce bel édifice vieux comme le monde. Elle insiste en tous domaines sur l'initiative du sujet connaissant, sentant, agissant. L'action morale pour Rousseau n'est pas l'accomplissement d'une loi préalable, elle se mesure à l'intimité vécue de l'intention ; le beau pour Hugo, au lieu d'accomplir l'ordre, éclate dans l'originalité et la vitalité du créateur ; la vérité pour Kant et Hegel n'est plus à abstraire ou à intuitionner, elle procède de l'esprit qui constitue (sinon crée) le réel. On n'oserait pas dire que l'idéalisme rompe tout à fait avec l'idée de nature : sentiment pour Rousseau, génie pour Hugo, esprit pour Kant et Hegel sont des réalités déployant une loi interne et possédant de nombreux caractères du déjà-là. Il n'empêche que s'amorce une brisure, une défiance à l'égard du donné, qui fuse chez Kierkegaard, explose en orage chez Nietzsche, et connaîtra jusqu'aujourd'hui d'innombrables échos, étouffés ou grondants, dans les mille variétés du subjectivisme. Par exemple, et malgré le paradoxe des vocables, le naturalisme fin de siècle sera une des plus nettes mises en question de la réalité objective : il n'est si acribique dans le détail, il n'accumule avec tant d'impatience les petites notations que parce qu'il n'y a plus pour lui que des fragments, des éclats de nature, - c'est-à-dire plus de Nature du tout [74].
De l'avis unanime, les orientations actuelles inaugurent un troisième moment et se proposent de dépasser simultanément le réalisme et l'idéalisme. Comme nous le reverrons, l'art pris chez les maîtres ne croit plus à l'objectivité toute faite d'une nature qu'il n'y aurait qu'à exprimer ; il refuse avec la même force le simple cri de la subjectivité orgueilleuse ou lamentable, pour tenter de construire une réalité où l'homme et la nature se conjugueraient. La science cesse de se confondre avec un constat réaliste ou un diktat idéaliste, et se découvre un système à mi-chemin entre nature et esprit. L'éthique n'ose plus se présenter comme un code de prescriptions ni comme la légitimation romantique de la fantaisie anarchisante : sous sa forme marxiste, existentialiste ou personnaliste, elle noue une expérience vivante où esprit et nature n'ont jamais fini de dialoguer et tissent une réalité croisant le fait et la liberté.
Ces trois étapes des civilisations vis-à-vis de la nature sont évidemment parallèles aux trois étapes déjà reconnues dans l'histoire de la technique. La machine statique en continuité avec le corps humain et son milieu, s'harmonisait avec une conception des choses où l'homme pouvait demander au réel s'il était sensible, intelligible, fluent, stable, immanent, transcendant, mais où il ne songeait, en tout état de cause, qu'à s'y conformer, dans une attitude réaliste. La machine dynamique, en rupture avec l'environnement et surgissant, croyait-on, d'un calcul de l'esprit, correspondit à la saisie idéaliste de l'existence, avec tantôt la révolte romantique du sentiment frustré, tantôt l'affirmation souveraine de l'intelligence constructrice, qui trouva en Hamelin, Whitehead ou Brunschvicg, des représentants jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Quant à la machine concrète, parée de synergies entre elle et son milieu, entre sa matière et sa forme, elle est en plein accord avec une représentation du monde où forces de la nature et initiatives de l'esprit se conjuguent en une réalité intermédiaire.
En effet, quelle image des choses nous propose-t-elle ? Le réseau tend à recouvrir l'univers, interconnectant de proche en proche les diverses machines, les centres urbains, les systèmes routier, ferroviaire, fluvial, aérien, hertzien, et jusqu'à l'agriculture industrialisée. Il envahit le désert et les pôles aménagés par une agriculture semi-artificielle, industrialisés par les fours solaires ou par l'énergie atomique aisément transportable, utilisés comme plates-formes pour des vols de toutes sortes, inclus dans les relais de radars et de transmissions diverses. Il y joint l'océan à propos duquel se renouvellent dans un style plus efficace les spéculations d'autrefois sur l'énergie des marées, sur les ressources du plancton, sur la redistribution des courants maritimes par une refonte des détroits et des isthmes. Enfin, grâce aux satellites artificiels, l'espace cosmique entre à son tour dans le circuit, tant par l'établissement de routes spatiales que par des modifications escomptées de la haute atmosphère améliorant le cycle des saisons et les plafonds de résonance de nos systèmes de télécommunication. On le voit, le filet est universel, et il est serré, d'autant plus qu'il ne résulte pas d'une simple accumulation d'engins et de procédés, comme dans le cas de la machine du XIXe siècle, mais forme un véritable tissu où tous les éléments renvoient sans cesse à tous les autres, arrêtant le regard aux rapports inépuisables de leurs interactions, et empêchant de les dépasser vers cet au-delà ou cet entour : la terre vierge.
Encore faut-il noter que cet écran ne s'en tient pas à couvrir en surface, mais transforme en profondeur : c'est un vêtement qui annexe ce qu'il recouvre. Déjà le milieu associé nous avait paru si intimement uni au régime de certaines machines d'énergie et d'information qu'on ne pouvait trancher s'il était encore la nature ou machine lui-même ; Simondon le dit techno-géographique. Mais la fusion de la technique et du paysage est surtout sensible dans les grands projets de transformation climatique : nous défiant des procédés purement artificiels de type abstrait et linéaire, telle l'émission d'iodure d'argent à haute altitude, nous envisageons des aménagements globaux, où l'introduction d'une culture modifierait le taux de pluie, favorisant alors une nouvelle culture réformant à son tour le taux de pluie, dans un cycle où la nature ne serait ni souveraine ni isolée mais insérée dans un schéma fonctionnel à la façon d'un organe ou d'un moment [75]. De même, dans la production de la nourriture, nous n'avons plus la soumission de l'homme ancien attendant sa provende de la bonne volonté des éléments, ni l'intransigeance dynamiste de Berthelot qui nous voyait, pour l'an 2000, nourris de pilules combinées par la synthèse chimique : nous savons que dans la production alimentaire la nature s'y prend et s'y prendra sans doute toujours plus économiquement que nous [76] ; mais si nous ne songeons pas à fabriquer cette algue très nourrissante qu'est la Chlorella, nous avons entrepris de la cultiver dans des tuyauteries transparentes où elle profite à la fois de la lumière solaire et des quantités optimales d'azote et de carbone, en un dispositif mi-artificiel mi-naturel, où la nature une fois de plus est annexée comme organe et comme moment.
Enfin, il ne s'agit pas seulement d'annexion, mais d'incorporation véritable. Rappelons-nous la synergie de la matière et de la forme dans la machine dialectique ; et surtout alléguons ici encore l'exemple plus vaste et plus saisissant des conceptions agricoles. Le sol, pour la mentalité statique, était bien une matière à laquelle l'être humain donnait une certaine empreinte de son initiative, une forme, mais dont il devait respecter les vertus. En réaction, l'artificialisme dynamiste médita ou bien de s'en passer entièrement (Berthelot attendait que les champs cultivés cessent de défigurer les campagnes), ou bien d'en faire un pur réceptacle, lieu neutre où le végétal serait mis en contact avec les produits que nous y aurions déposés pour sa croissance industrielle. La mentalité dialectique envisage une compénétration presque absolue des pôles humain et naturel : commençant par reconnaître l'originalité du terrain, dont la texture, loin d'être neutre, stimule les échanges chimiques entre la plante et l'engrais, elle ne prétend pas moins en disposer, pénétrant cette texture de substances, tel le Kryllium, qui mettent sa matérialité même en forme. Et l'on puiserait à pleines mains dans nos produits synthétiques, - tissus, matériaux, aliments, - mille cas semblables d'incorporation. Peu importe qu'un certain nombre des exemples avancés soient moins des résultats que des projets : ils dessinent un avenir si proche qu'ils font déjà partie du monde que nous voyons et éprouvons ; et d'ailleurs ce qui compte ici, - soulignons-le pour toutes les analyses à suivre, - c'est moins le visage pris physiquement par la nature que celui qu'elle reçoit, en nos esprits, de la nouvelle mentalité. Peu importe également que plus d'une technique invoquée soit bientôt caduque : tout est si changeant dans le monde synergique que le Kryllium et la Chlorella ne domineront sans doute pas l'agriculture de demain ; mais ce sera pour faire place à des procédés où univers et initiative humaine seront encore plus étroitement confondus.
Bref, le monde technique, tout en se naturalisant, technicise désormais la nature en la recouvrant de son extension, en l'annexant comme organe et comme moment, en transmuant sa matière même dans sa substance à lui. Pour autant il n'est plus un troisième règne entre homme et nature, un métacosme selon Dessauer [77], car il ne vient pas s'ajouter aux deux autres en les laissant intacts ; c'est plutôt un nouveau règne unique, incluant, croisant en soi les deux autres, se substituant à eux en les mettant en des rapports qui les réinterprètent, - ce que nous avons appelé d'un mot impropre, parce qu'il n'exprime pas cette unicité, une réalité médiane [78]. A la limite de la concrétude il n'y a plus ni nature ni artifice, mais une synthèse originale et mouvante, qu'on peut appeler équivalemment une nature artificielle ou un artifice naturel. Si l'urbanisme de l'avenir nous réserve des « zones de silence » et des « bandes vertes », ce sera encore pour inclure la nature au réseau : là même elle fonctionnera.
On voit combien il serait superficiel de vouloir justifier ou critiquer notre technique en l'envisageant comme moyen. Quand une réalité prend des dimensions si envahissantes, quand elle remplit si bien le monde sensible que, dans la majorité des cas, elle voile et même remplace toute autre réalité, est-elle encore un moyen ? Un paysage n'est pas un moyen : il est le milieu [79], le monde-autour-de-nous, l'Umwelt. La technique concrète ne représente nullement un intermédiaire, un médium qui s'interposerait entre nous et des buts au-delà ; la plupart du temps elle est le but même de nos actions, et nos actes s'y terminent. Chaque objet technique pris en particulier offre évidemment le moyen d'une action ou d'un autre objet, mais le réseau est le monde même dans lequel nous nous agitons ou reposons. Et comme, par ses synergies, il s'étend indéfiniment dans l'espace et, par le processus de concrétisation, dans le temps, la technique concrète forme non seulement notre paysage, notre Umwelt, mais notre horizon.
Cette affirmation est d'une conséquence culturelle incalculable. La Nature, - Terre, Terre-Mère, Déméter, Cybèle, Isis, Physis, Thalassa, Désert, Fleuve, Montagne, - avec ses mille autres faces, a été pour l'homme, depuis l'origine, le fondement de toutes ses valeurs. Source de vie, sein maternel, feu brûlant ou chaleur féconde, déluge et crue, sécheresse et pluie bienfaisante, limon ou lœss, elle avait été d'autant plus fascinante et redoutable, plus sacrée, que despotiquement elle donnait sept années de vaches maigres pour sept années de vaches grasses, semait d'une main l'épidémie et de l'autre la guérison. Elle porta toutes les poétiques, les plastiques, les rhétoriques, les philosophies, les liturgies, bref tous les humanismes, et lorsque, après des millénaires de réalisme, certaines formes d'idéalisme voulurent souligner la primauté de l'esprit, elle resta présente comme racine ou comme regret. L'ère dynamique de la machine n'y put rien faire : en la refusant, elle ne fit qu'exaspérer le sentiment de tout homme de culture : Péguy pouvait encore rêver de « mourir pour quatre coins de terre », pour la « terre charnelle ».
Notre but, nous l'avons dit, n'est pas de dessiner l'humanisme de demain. On doit néanmoins prévoir que sa poétique, sa plastique, sa rhétorique, sa philosophie, sa liturgie [80] ne pourront plus faire fond sur la nature ancienne. Elles ne pourront même plus, dans leurs images, l'invoquer comme horizon, s'il est vrai que la technique concrète est notre horizon. Mais il sera tout aussi exclu qu'elles se réfugient dans l'intériorité hautaine où elles se sont repliées pendant la transition idéaliste : vu l'expansion qu'il suppose, un humanisme ne s'est jamais bâti sur la subjectivité, si raffinée, si émouvante fût-elle.
En sorte qu'on aura beau faire, les thèmes culturels féconds se situeront dans le plan de cette réalité médiane où nous enclôt la nouvelle mentalité technique. Est-ce là un champ assez vaste, assez profond en regard de l'ancienne nature, pour alimenter l'inlassable besoin de renouvellement, de création d'un humanisme ? Il le semble puisque cette réalité est coextensive à l'ancienne, qu'elle lui apporte même de nouvelles dimensions. Si la technique ne dépassait pas son statut de moyen, la proposer comme horizon nous condamnerait, bien sûr, au non-sens d'un monde où tout ne serait plus que moyen-de-moyen. Mais précisément en s'accouplant à la nature pour former une réalité médiane, paysage et horizon, la technique concrète cesse d'être un serviteur pour devenu* culturelle dans son être. Impliquant la nature dans ses totalités synergiques, elle ne présente pas seulement des utilités mais des formes, au sens gœthéen de ce qui ne s'épuise pas dans le renvoi à autre chose, mais offre par soi-même, dans sa complétude, un sens.
2B. L'ESPRIT INSTAURATEUR
L'idée de nature était si forte dans les cultures anciennes que même l'esprit fut conçu sur son modèle. Somme toute, lorsque Descartes voyait dans l'âme une chose pensante face à la chose étendue, il tenait le langage du bon sens, celui de tous les hommes lettrés ou illettrés d'autrefois. En regard de la nature visible et extérieure, l'esprit était invisible et intérieur, mais donné, chose quand même, consistante, suffisante. Ses relations avec le monde avaient l'aisance du cavalier sur son cheval, selon la populaire image de Platon.
On pourrait croire que la technique ancienne ne légitimait pas de pareilles vues. La grossièreté des procédés de coulage et surtout le fait que les énergies humaine, animale, hydraulique, éolienne se transmettaient par des systèmes d'arbres et de couplements où toute distance et toute bifurcation occasionnaient des pertes de rendement considérables, acculaient l'artisan à des prodiges de dextérité manuelle et d'invention plastique qui, loin d'en faire un pur esprit, le contraignaient à chercher ses idées au hasard de démarches très humbles, par essais et erreurs, « enlevant de-ci, ajoutant de-là », comme dit Philon de Byzance à propos de ses catapultes ; ainsi le comprenaient les règlements d'apprentissage qui communiquaient le tour de main par un contact vécu de maître à apprenti. On s'attendrait donc à ce que les philosophies de l'époque aient conçu l'homme avant tout comme un ensemble de gestes, à travers lesquels une pensée se cherche sans arriver à jamais parfaitement se posséder. Or il n'en fut rien. était-ce que, par la division des classes sociales, le philosophe n'était pas lui-même artisan ? Au vrai, la machine ancienne suggérait à tous une conception orgueilleuse. Sans doute son utilisation, sa fabrication et surtout son invention supposaient des manipulations très physiques, mais la forme technique une fois réalisée apparaissait si élémentaire, si évidente en ces premiers temps, que l'esprit pouvait se faire l'illusion de l'avoir conçue par les seules ressources de son intuition (intellectuelle ou sensible, peu importe) et de son raisonnement, indépendamment du geste ; la matière paraissait un réceptacle rétif à la forme, et le geste une exécution défaillante de l'idée [81]. L'homme libre prenait donc garde de se salir les mains. Le sage devait se réfugier dans l'esprit, devant les choses, au-dessus d'elles, - lui-même chose pensante, suffisante.
L'avènement du dynamisme ne fit que renforcer cette hauteur. Rompant avec l'empirie, il pénétra la technique de science, humiliant encore la manipulation. Dans la machine de Watt confluent les recherches de trouveurs comme Savery et Newcomen, mais aussi de théoriciens comme Galilée, Torricelli, Guericke. Lorsque, en 1794, la Convention fonde la première école polytechnique, le grand Carnot et Monge y appellent les héritiers du saeculum mathematicum, Lagrange, Laplace, Legendre, Fourier. La thermodynamique inaugurée par Sadi Carnot en 1824 fera penser que toute machine thermique se réduit à la projection d'une théorie générale. Et ce sentiment fut confirmé par les applications de plus en plus nombreuses, depuis 1850, de la chimie et de l'électricité, où il est si difficile de départager ce qui revient au physicien et au technicien. Il est vrai qu'une pléiade de techniciens allemands réagit contre cette assimilation et suscita une prise de conscience qui aboutit, en 1875, à la fondation du Laboratoire de Technologie expérimentale de Munich ; mais pour le grand public et la majorité des auteurs la technique continua de faire figure de science appliquée. Et l'on ne voit pas comment il en eût été autrement. Ces engins encore abstraits, où chaque fonction était réalisée à part soi, se présentaient comme un faisceau de lois physiques successivement incarnées. Plus que jamais l'esprit put se sentir indépendant des manipulations extérieures dans la conception des structures techniques : n'étaient-elles pas les simples applications des vérités découvertes par son raisonnement et par son intuition, sensible pour l'empirisme, intelligible pour l'idéalisme, dont les systèmes jalonnent toute la période ? Au geste, à la manipulation explorante, à la technique tenue pour vulgaire, demeurait seulement le résidu des problèmes d'exécution où la science n'avait pas encore apporté toute sa limpidité théorique.
La technique concrète a profondément modifié cet état de choses. En présence de nos engins et de nos procédés, l'esprit ne peut plus se faire l'illusion que la manipulation, l'exécution sont indifférentes et que seules compteraient ses actes d'intuition et de raisonnement, car il saute aux yeux qu'une synergie ne s'accomplit pas par pur raisonnement. Un statoréacteur, une turbine Guimbal, une penthode, une machine de calcul ou de comportement, un plan économique ou climatique récent présentent une structure globale, totale, dont l'efficacité ne résulte pas de l'action successive des éléments, mais de leur interaction. La compréhension de l'objet peut alors exiger en certains cas - sinon de droit, du moins de fait - qu'il soit entièrement achevé : c'est après sa mise en tension qu'on vit, en 1958, à l'Exposition de Bruxelles, la couverture du pavillon français tirer sur les façades au h'eu de s'y appuyer, et c'est dans le fonctionnement de Machina speculatrix que Grey Walter s'aperçut qu'elle donnait lieu à des types imprévus de comportement. Quand on ne doit pas attendre l'objet achevé, il y faut du moins des modèles : l'architecte, nanti des formules de résistance des matériaux, n'a jamais tant calculé qu'aujourd'hui, jamais non plus il n'a tant travaillé sur maquette, car seule celle-ci lui permet de mettre au point ces structures synergiques que sont tel paraboloïde hyperbolique dans la construction matérielle, tel plan libre dans la conception spirituelle du bâtiment. Bien plus, même quand l'architecte ou l'inventeur d'une turbine se passent de maquette et se contentent de la planche à dessin, leur travail dans la mesure où il est synergique se présente non comme une simple inscription de lois physiques, mais comme une recherche vivante, éprouvante, manipulante d'une configuration spatiale, plastique. Et dussent-ils quitter un instant les règles et les tracés pour continuer leur méditation dans un fauteuil, c'est encore de manipulation qu'il s'agit. Le dialogue entre le projet et l'objet peut devenir aussi mental qu'on le voudra, l'esprit instaurant une technique concrète se conçoit non comme une réalité régnante, seulement intuitive et analytique, mais comme un principe ouvrier, cherchant ses voies à travers des gestes tantôt physiques tantôt imaginés, tâtonnants ou vainqueurs, jusqu'à ce que l'ensemble des données réalise tout à coup, ou par à-coups, une nouvelle forme, un nouvel équilibre, plus compréhensif que l'ancien.
De bons esprits semblent s'inscrire en faux contre cette thèse : l'âge actuel serait caractérisé par une absorption de la technique dans la science, et rien n'est plus stupide que la politique des brevets protégeant les inventeurs d'engins et négligeant les inventeurs d'idées, souvent plus féconds ; le règne du plasticien et du manipulateur, lié aux carences de la machine ancienne, serait révolu, et, si l'on doit établir un circuit, « mieux vaut faire une application habile de principes statistiques et du calcul des variations pour trouver le meilleur circuit possible, que de procéder par tâtonnement »[82]. Mais d'abord parler de la sorte c'est faire la part trop belle aux machines d'information, nerfs d'un réseau qui continuera de compter des muscles, les machines d'énergie, où l'effort de configuration est patent [83]. D'autre part, même dans les machines d'information, l'acte configurateur reste premier : un circuit n'est pas une machine ni un système machinique, il est un aspect, une coupe sur l'objet dont l'idée complète est la mise en forme d'une situation, où l'épreuve spatio-temporelle (si épurée qu'elle soit) mène le jeu. Par conséquent, s'il est vrai que la technique se pénètre toujours plus de science, si ses bonds en avant sont étroitement conditionnés par les progrès de la recherche fondamentale, s'il faut donc orienter la politique des brevets et des subsides vers les recherches à long terme, science et technique n'en sont pas moins distinctes, l'une découvrant des lois, l'autre configurant des objets en situation, qui mettent ces lois en œuvre sans s'y réduire. Aussi, rien n'est plus faux que de croire que l'idée de manipulation créatrice appartient aux imperfections de la technique primitive ; c'est au contraire depuis qu'on ne la confond plus avec la sueur qu'elle est apparue liée à l'exercice instaurateur de l'esprit, cherchant ses projets et ses idées à travers des gestes au moins esquissés. Enfin, comme nous y reviendrons dans notre deuxième partie, il ne faut pas perdre de vue que la science dont la technique concrète se rapproche n'est plus celle du XIXe siècle qui, procédant par intuition et raisonnement, envisageait l'esprit indépendamment de ses démarches corporelles, mais une science qui, devenue à son tour dialectique, s'est rendu compte qu'elle aussi impliquait une part de manipulation.
Et une fois de plus, un caractère mis en relief sur un cas tranché s'est révélé universel. Nous étant découverts ouvriers dans l'édification des schèmes machiniques concrets, nous nous sommes avisés qu'au fond nous l'avions toujours été dans l'invention éotechnique et paléotechnique, même si la facilité d'alors avait pu nous faire illusion : tout instrument technique, si simple soit-il, est bien le fruit d'un acte de configuration [84], - plus ou moins stéréotypé ou créateur ou instaurateur [85] selon les cas, - différent de la découverte et de l'application d'une loi, et supposant une manipulation spatio-temporelle, directe pu indirecte, des éléments en situation. Du coup, nous vîmes mieux que l'artiste, cet autre configurateur, - désintéressé [86] seulement, - était lui aussi depuis toujours parti non d'idées toutes faites mais d'un geste, allant du coup de ciseau du sculpteur au balbutiement du vers par le poète, ce qu'on appelle l'idée n'étant d'abord qu'un projet vague qui se remplit et se détermine dans une exécution, que Delacroix déjà disait créatrice. Enfin, psychologues et sociologues montrèrent que nous avions procédé de la même manière opérative - nous ne disons pas empirique - dans la constitution de nos lois et de nos morales. Bien entendu, il n'est pas question de soutenir que la technique concrète à elle seule ait fait la découverte de ce statut ouvrier de l'esprit, - science, éthique, art, nous le verrons, sont arrivés, chacun sur leur terrain, au même résultat, - mais elle en est sans doute l'illustration la plus saisissante, et donc culturellement la plus efficace. Elle n'est en tout cas pas étrangère au fait que toutes les philosophies et psychologies actuelles répètent que nous nous saisissons dans et sur les choses, dans et sur nos démarches à leur égard ; que la pensée n'est pas un phénomène initial et suffisant, mais une reprise, toujours renouvelée et toujours menacée, d'un dedans sur un dehors.
De nouveau, nous n'avons rien à prescrire, mais il va de soi qu'il sera bien difficile à l'avenir d'encore concevoir l'humanisme, - comme l'avaient fait toutes les cultures anciennes, - à la manière d'un retrait dans l'isolement de l'esprit créateur. La seule façon pour la pensée de se saisir semble bien devoir être de se tourner vers ces choses dont elle se sait dorénavant tributaire, en sorte que son recueillement consistera moins dans un silence autarcique que dans le déchiffrement attentif des apparences et l'engagement opératoire. Telle paraît même sa seule chance d'intériorité véritable. Mais n'est-ce point là sa mort et celle de tout humanisme ?
Dans le vaste domaine de la culture, à ne s'en tenir pour le moment qu'aux techniques, n'oublions pas que les choses neuves vers lesquelles la pensée se voit contrainte de sortir, ne sont pas objets morts ou moyens-de-moyens, c'est cette réalité médiane, où elle trouve ses propres structures réalisées, la prolongeant et revenant à elle pour la stimuler. Une forme technique concrète, par l'intimité de ses interrelations, par les réorganisations globales de son développement, par son croisement de nature et d'intention, qu'est-ce d'autre que la pensée s'apparaissant à elle-même et recevant sur soi les plus profondes leçons ? On n'avait jamais conçu clairement que notre structure psychologique n'était pas additive, analytique, mais globale ; et la Psychologie de la Forme se noue vers 1912. On n'avait jamais senti non plus que notre liberté ne se limitait pas à une possibilité de choix entre des réalités toutes faites, mais qu'elle avait le pouvoir de remodeler le réel, de le refondre, forme et matière, dans des structures vraiment neuves ; et toutes les théories existentialistes et autres sur le pouvoir instaurateur de la liberté s'amorcent entre les deux guerres. Jamais non plus, avant de se saisir comme contraint de se récupérer sur l'objet qu'il instaure, l'esprit n'avait deviné qu'il n'était pas nature lui-même, mais plutôt cette faille, ce vide-dans-le-plein par lequel s'introduit le mouvement et l'histoire ; et c'est à la veille de la Deuxième Guerre que Sartre propose de concevoir la conscience comme une « néantisation ». Ici encore on ne peut dire que la technique concrète ait à elle seule provoqué les prises de position : la science pure, l'art et l'éthique y ont leur part originale ; mais elle leur a donné une figure et les a fait voir avec une force qui les impose populairement, qui les transforme en ressort culturel.
Bref, tout s'est passé comme si l'esprit avait découvert sa dépendance à l'égard de ses œuvres au moment où celles-ci se pénétraient assez de spiritualité pour être le miroir et le stimulant de ses montages cérébraux, de ses comportements, si complexes soient-ils, et pour l'inciter en même temps à percevoir son caractère irréductible de conscience, de distance sur tous les donnés, par quoi il les promeut. Il n'est donc plus impensable qu'il se recueille dans le moment même où il se porte vers l'extérieur, en saisissant le dehors comme un dedans [87].
2C. LA SOCIÉTÉ SANS CLASSE
La technique ancienne favorisait la division de la société en classes hostiles. La machine statique arrivait moins à vaincre le dénuement qu'à le souligner en permettant à quelques privilégiés l'accès au luxe. La machine dynamique, qui mit un terme à la rareté, suscita l'opposition entre hommes d'affaires, techniciens et cheptel de fonctionnement, et cette coupe fut plus dure encore, car, si le vieux clivage en riches et pauvres avait quelque chose de naturel qui le rendait supportable, le nouveau, fruit d'un effort d'artifice et de prise en main de l'homme par l'homme, parut un état si volontaire, il enferma l'ouvrier dans des tâches si inhumaines au milieu d'un dessein général d'humanisation, qu'il allait renforcer la lutte des classes partout où la grande industrie prendrait les commandes.
A en croire certains théoriciens, la machine actuelle aggraverait cette situation. Elle conduit au réseau, et le propre du réseau est d'être suspendu à son centre de contrôle. En détruisant une centrale électrique, en dérangeant un central téléphonique, on paralyse une région ; en régentant un émetteur de radio ou de télévision, on débande ou on galvanise un pays. Et Russell [88] voyait le plus grand danger de l'avenir dans cette possibilité pour une poignée d'aventuriers, de droite ou de gauche, de s'emparer des leviers et, moyennant une classe intermédiaire de policiers attachés par des privilèges, d'exploiter une humanité asservie. Il en dépistait les prodromes dans l'hitlérisme et le communisme stalinien.
Mais Russell comprenait le réseau dans une perspective dynamiste : il le voyait comme une suite d'initiatives partant d'un centre, et de productions remontant vers un centre, selon un processus strictement linéaire. Or le réseau concret a des foyers multiples. En raison de la synergie, les éléments sont eux-mêmes des nœuds secondaires, et les nœuds secondaires, des nœuds principaux. En sorte que le sommet - pour autant qu'il y en ait encore un - se trouve en rapport de réciprocité avec la base. Et par là nous ne voulons pas invoquer le lieu commun que dans une société tout est tributaire de tout, au sens où Sully Prudhomme s'extasiait sur la dépendance mutuelle du boucher et du prince, car cette dépendance-là est compatible avec la plus profonde servitude ; nous ne voulons pas dire seulement que cet état de la machine suppose une qualification généralisée de la main-d'œuvre, car dans les systèmes linéaires du dynamisme on peut prévoir aussi des qualifications, mais abêtissantes et esclavagistes, même quand, par-delà le travail à la chaîne, elles s'élèvent à des tâches intellectuelles : il y a une intelligence qui enrégimente au lieu d'éveiller, comme le national-socialisme en a fourni la preuve. Mais justement, dans le réseau dialectique, l'interdépendance et la qualification ne peuvent se limiter à l'exécution sclérosée. Les objets à manipuler étant synergiques, un nombre toujours plus grand de travailleurs se voit contraint d'accéder à une connaissance critique, inventive et portant sur des ensembles variés et larges [89].
Qu'il ne s'agisse pas là d'une vue de l'esprit est assez prouvé par l'insistance des économistes sur l'urgence d'une formation qui, à tous les postes, ne soit ni la spécialisation étroite où se confinent encore beaucoup d'écoles techniques, ni l'ancienne culture générale planant au-dessus ou à côté des spécialisations, mais une formation qui branche chacun, à travers sa spécialité, sur l'ensemble où elle fonctionne, de telle sorte qu'il la dépasse assez pour être apte au moins à saisir les réorganisations de l'ensemble. La démocratisation des études à laquelle nous assistons n'est pas seulement une mesure humanitaire, sinon elle n'eût pas abouti, mais une nécessité du réseau concret. Celui-ci suppose des compétences très hautes, - qu'on songe aux super-universités comme Princeton, - mais aussi une très large base de main-d'œuvre compréhensive et inventive, besoin qui va si loin qu'on est allé jusqu'à préconiser un certain abaissement du niveau des études pour en généraliser l'accès.
Il s'ensuit que, contrairement à l'opinion de Russell, une société de pure exploitation est incompatible avec une technique concrète développée. Il se peut qu'une clique s'empare d'un réseau synergique et le détruise, mais non qu'elle le développe ou même l'entretienne, à moins de cesser progressivement d'être une clique et de favoriser, bon gré mal gré, l'émancipation et la réciprocité. C'est ce qu'illustra la société stalinienne, partie d'une dictature policière, et se muant, par la logique même de la technique qu'elle instiguait et qui glissait de l'abstraction à la concrétude, en une société où l'esprit critique et les valeurs de réciprocité finirent, sans doute à l'insu et contre le gré des promoteurs, par appeler un climat plus humain [90].
D'ailleurs, la technique concrète corrode toute classe, quelle qu'elle soit. Si l'on entend par là un groupe quelconque d'individus possédant les mêmes intérêts et les défendant avec une certaine astuce et une certaine fierté, il va de soi que les sociétés humaines en comportent toujours. Mais le mot sous-entend davantage. Il implique que le groupe en question s'oppose aux autres, qu'il se juge naturellement supérieur ou inférieur, qu'il s'attribue une mission irremplaçable inscrite dans l'ordre des choses, même si cette mission, comme pour le prolétariat marxiste, est de renverser tout cloisonnement. Or pareille classe, au sens fort, est inlassablement battue en brèche, émiettée du dedans par la machine concrète. Celle-ci donne lieu à une réciprocité et à une réorganisation des fonctions qui fait apparaître leur contingence et empêche leur sacralisation en classe. Nous assistons à une laïcisation du rôle. Il y a quelques années encore, un homme était un commerçant, un intellectuel, un militaire ; un aristocrate, un bourgeois, un ouvrier ; un citadin, un paysan ; un colonisateur, un colonisé. Il lui en reste un souvenir, mais le monde dans lequel il vit, la manière dont sa fonction s'y exerce, l'acculent de plus en plus à n'apparaître aux yeux des autres et aux siens propres que comme un homme. Point de place pour les aristocraties stables du sang, de l'argent ou de l'investiture, mais seulement pour une demi-élite générale, d'où émerge aux endroits les plus divers et selon des besoins extrêmement variés et momentanés, une super-élite fluente [91]. Des classes se reforment sans cesse, mais elles se défont à mesure, et pour autant n'en sont plus [92]. Et l'on en dirait autant des nations : il y a dans le réseau dialectique un ferment d'unanimité ; non seulement il oblige à concevoir des ensembles politiques et économiques de plus en plus vastes mais, de gré ou de force, il les conjoint de plus en plus étroitement [93]. Reconnaissons que l'amenuisement de la classe ne promet pas, par lui seul, un avenir culturel. Il fut souvent dans le passé un signe de fatigue, et on dénonce aujourd'hui l'atonie de certains milieux américains portés par la nouvelle mentalité technique vers un abaissement des barrières sociales. Cependant un livre comme L'homme de l'organisation de William Whyte [94] nous suggère de l'optimisme précisément par ses critiques. Il témoigne d'une stagnation, mais dénoncée, et donc déjà dépassée, par un auteur et par un public. La technique concrète, du fait qu'elle inclut le social comme un de ses facteurs, le propulse du dedans. Un réseau bâti sur la synergie de la machine et de l'homme favorise des human relations dont les conséquences peuvent être niveleuses, voire oppressantes, mais ses nécessités d'invention le contraignent, à brève échéance, à les éprouver comme telles et à les contrarier. Pour pasticher une formule heideggérienne, la société de demain sera, par structure, sans cesse en question dans sa structure même. Si elle semble pouvoir se promettre un avenir créateur, ce n'est pas qu'elle ignorera l'enlisement et le déséquilibre, mais que ceux-ci, en vertu des besoins de différenciation et de réorganisation du réseau concret, y seront toujours, tôt ou tard, relevés et entrepris.
2D. LES LIMITES CONFIRMANTES
Ce qui précède nous porte à croire que la technique concrète répond au premier critère d'une civilisation viable : la créativité [95]. Satisfait-elle aussi bien au second : l'autorégulation, ou capacité de rétablir l'équilibre quand il est compromis ? La chose semble aller de soi, puisqu'un grand nombre de nos structures cybernétiques ont précisément pour objet d'assurer des homéostasies, et que le feedback est devenu un concept aussi familier à l'économiste et au sociologue qu'à l'ingénieur. Il n'en demeure pas moins qu'un réseau concret, si on le prend dans toutes ses implications humaines, est, de ce point de vue, doublement menacé.
2D1. La difficile prévision
La vieille nature avait ses vices mais aussi ses avantages. Son cours envisagé à grande échelle dans l'espace et dans le temps était passablement autorégulateur. Avec ses lois simples de sélection naturelle, d'adaptation au milieu, de compensation par anticorps, elle finissait toujours par restituer la santé après les pestes et la savane après l'incendie. Même le psychisme humain, bercé ou choqué par elle, faisait alterner déclins et renaissances. Au contraire, si la technique synergique permet à l'homme, pour la première fois dans l'histoire, de dominer son sort en créant une nature artificielle, si elle gouverne le paysage, la conservation et la propagation de l'espèce, l'éducation, le métier et jusqu'à l'opinion, éliminant ainsi les mauvaises autorégulations à court terme, il n'est pas évident qu'à long terme elle réussisse aussi brillamment.
Il est à redouter que la synergie, en raison même de sa cohérence, entraîne en certains domaines des détériorations irréversibles. La chose n'est guère probable dans les machines proprement dites, où l'on peut toujours corriger un programme fâcheux. Elle l'est déjà davantage en médecine, où l'artificialité alimentaire, l'usage d'antibiotiques, les radiations accrues pourraient engendrer à la longue des dégénérescences irrémédiables. Elle l'est surtout dans nos planifications économiques, sociales, éducatives. Les réorganisations globales des systèmes d'échanges, les campagnes d'opinion - dont celles qui ont favorisé l'hygiénisme mental en Scandinavie, le conformisme social aux U.S.A., le bellicisme en Chine ne sont que les avant-courrières - pourraient fort bien, à mesure que leur action se fera plus concertée et plus étendue, déborder leurs mécanismes de compensation.
Il faudrait donc être en mesure de prévoir de très loin [96]. Or, la prévision s'avère difficile dans un monde synergique du fait que la claire vue d'un schéma concret suppose achevée sa conception, voire sa réalisation : il faut pour le juger en définitive connaître l'effet de chaque élément sur tous les autres, de tous sur le milieu, et inversement. On peut encore deviner assez aisément ce que deviendra un système machinique, par exemple quant à la résistance de ses matériaux, car on peut soumettre soit l'objet lui-même soit son modèle réduit à des épreuves (songeons aux souffleries pour les maquettes d'avions ou d'architectures) qui dessinent suffisamment son avenir : rien n'empêche ici de pratiquer un lesting to destruction riche en enseignements. Mais la tâche se complique déjà en médecine, où nous devons nous en remettre à de fragiles supputations statistiques pour soupçonner les effets à long terme d'une radiation. Et nous sommes pratiquement démunis en tout ce qui concerne le psychisme, où aucun calcul un peu strict, ni de résistance ni de probabilité, ne vient en aide. Nous voici donc affrontés à une situation paradoxale. Plus que toute autre technique, la synergie nous oblige à prévoir, et sa complexité nous empêche de prévoir là où la prévision serait le plus nécessaire.
Nul argument ne permet d'exclure ces suppositions pessimistes. Elles appellent néanmoins plusieurs restrictions. D'abord, il faut se garder d'imputer toutes les catastrophes du futur à l'idée de synergie. Si l'économie occidentale devait un jour connaître une nouvelle grande crise, voire une impasse, la faute n'en serait pas nécessairement à la volonté synergique qui l'anime de plus en plus, mais plutôt aux restes d'une mentalité dynamiste qui fit ses preuves dans la crise de 1930.
Ensuite, il est excessif de croire que toute prévision est impossible dans une synergie économique et psychologique. Un fonctionnement global se préfigure, sinon dans ses parties, du moins dans des totalités approchées ; et d'autre part, malgré ses brusques retours, il ne faut pas toujours qu'une dialectique soit consommée pour qu'on sache où elle mène. Il n'y a donc pas lieu de désespérer que nous réduisions l'immense écart qui sépare notre prévision dans les sciences humaines de celle dont nous jouissons dans les techniques physiques [97], - et cela d'autant moins que nous y sommes intéressés.
Enfin, quand on redoute de la synergie qu'elle s'emballe dans un sens exclusif et monstrueux, on oublie trop qu'elle n'est pas une construction idéaliste et que la nature artificielle édifiée par ses soins continue d'inclure la nature éternelle dans une relation dialectique. L'éducateur, l'économiste, le psychologue peuvent planifier ; dans la mesure où leur planification est concrète, elle se corrige sans cesse par la naturalité qu'elle assume. C'est dans les diktats du dynamisme que les clivages risquaient d'être définitifs, au lieu de se réduire à des phases de développement plus ou moins malheureuses.
Ainsi, si l'on ne peut exclure a priori l'hypothèse d'un dérèglement grave, voire fatal, dans les facteurs psychologiques d'un réseau synergique, le seul préventif se trouve dans le resserrement et l'extension de ses synergies. Les excès de la concrétude appellent la concrétude. Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, ses limites la confirment.
2D2. La violence atomique
Une deuxième limite du réseau concret lui vient de son produit le plus élaboré : l'arme atomique. Car c'en est bien un fruit. On a beau dire que ces engins qui font converger le réseau en un point où il se détruit, n'appartiennent pas à la mentalité synergique et sont donc une séquelle du dynamisme, il n'en reste pas moins que seule la technique nouvelle est capable de combiner les synergies motrices et informationnelles d'un poste de tir contre avions ou d'un missile intercontinental ; bien plus, qu'elle porte en soi la fabrication d'engins de ce genre comme possibilité et menace permanentes.
On ne saurait trop dénoncer le péril. Il semble surtout résider en ceci, comme Günther Anders [98] l'a bien vu, que les hommes paraissent inaptes à le penser. Les masses ne se sont guère mises en branle à ce sujet sinon sporadiquement ; les politiciens et les militaires continuent à parler et agir comme s'ils avaient en main des armes traditionnelles, simplement plus puissantes ; même les pacifistes, qui se targuent d'apercevoir la menace et veulent faire partager leur clairvoyance, s'expriment d'habitude en des catégories périmées, où l'on devine plus de bons sentiments que de vues objectives.
Cette impuissance n'a rien d'étonnant. Notre imagination et notre sensibilité sont incapables de réaliser pareil volume d'anéantissement, de percevoir la monstruosité d'un acte où il n'y a aucune proportion tangible entre l'effet (la catastrophe) et la cause (un tour de clé) ; où des milliers de kilomètres séparent l'agresseur et la victime ; où la victime elle-même, comme on l'a observé à Hiroshima, ne se sent pas l'objet d'une agression mais d'un cataclysme naturel ; où ne subsiste plus de haine, de passion, de chaleur de combat ni du côté de l'assaillant ni du côté de l'assailli : en sorte qu'un être incapable d'arracher une patte à une mouche, en tout cas de trancher la gorge à un de ses semblables, peut montrer la sérénité technicienne d'un Truman avant et après Hiroshima. Notre morale et notre droit échouent à qualifier des moyens qui ne sont plus d'aucune fin, sinon de l'anéantissement des moyens et des fins. Et notre vocabulaire ne réussit même pas à désigner le processus : il prévoit le terme de guerre, impropre, car on ne parle pas de guerre quand la victime est sans résistance, quand il est hautement probable qu'il n'y ait pas de vainqueur, sinon tellement mutilé qu'il ne se reconnaîtrait plus lui-même. Nous sommes intellectuellement et affectivement démunis devant l'arme atomique.
Cependant, nos engins de destruction deviennent si puissants qu'il est malaisé de délimiter leur territoire, et le réseau d'information entre agresseurs et défenseurs se resserre à tel point, les réponses entre les camps se font si instantanées que toute stratégie atomique semble devoir échouer aussi bien dans le temps que dans l'espace. A ce compte, notre armement nucléaire nous propose des catastrophes de plus en plus terrifiantes mais de moins en moins probables. Il est même à espérer que les impasses auxquelles il conduit susciteront, dans un avenir plus ou moins prochain, un sursaut de la conscience politique qui le mette hors-jeu.
Quoi qu'il en soit, et c'est la conclusion qui concerne notre propos, les fusées atomiques ne changeront rien à l'actuel processus de concrétisation. Elles peuvent toujours à un moment quelconque le supprimer ; elles ne peuvent ni ralentir ni incurver son cours. Le fait que l'homme sache désormais non seulement qu'il est périssable (ce dont il s'est toujours accommodé), mais que sa culture et peut-être l'humanité entière sont à tout instant périssables semble trop au-delà de ses forces de représentation pour lui donner ce sentiment d'horizon bouché qui freine les cultures et sonne les décadences. Non, que la défense humaine contre la menace nucléaire s'oriente vers un armement pléthorique ou qu'elle nous accule, par un retour dialectique, à un désarmement général et un abaissement des frontières, son seul rôle culturel - mise à part une éventuelle annihilation - ira vers un renforcement de la synergie, machinique dans le premier cas, économico-politico-sociale, dans le second.
Nous en revenons toujours à l'idée que la concrétude nourrit la concrétude. Si bien que les schèmes dialectiques avec toutes les conséquences que nous leur avons reconnues dans l'ordre de la nature artificielle, sont les seules à s'inscrire pour nous dans la ligne d'un avènement de culture réfléchi.
* * *
La technique synergique a si profondément façonné le temps et l'espace où nous nous mouvons, ses structures commandent si intimement nos gestes, nos pensées, nos désirs, qu'il ne serait pas impossible de déduire de ses caractères généraux ceux de tous les autres domaines de notre culture : de la science, de l'art, de l'éthique.
Mais il y aurait un danger à cette manière de faire. Ce n'est pas parce que deux secteurs culturels offrent des traits semblables que l'un les a nécessairement empruntés, même si l'autre est plus voyant ; ils se sont peut-être inspirés dans un éclairement réciproque, à moins qu'ils ne procèdent tous deux de ce qu'il faut bien appeler, avec la Kulturgeschichte, un esprit de l'époque, qui sans doute ne tombe pas du ciel et résulte des œuvres accomplies, mais en croisant leurs influences a élaboré une synthèse originale d'images, de sentiments, de volontés qui retourne alors vers les œuvres pour leur donner, dans les secteurs les plus divers, des traits communs. D'autre part, s'il faut reconnaître, avec Marx, que les conditions techniques commandent fondamentalement un moment culturel, on n'en doit pas moins ajouter - comme Marx le fait incidemment et comme le marxisme existentialiste y insiste - que les superstructures sont originales, qu'elles réagissent spontanément sur les infrastructures, qu'elles comptent aussi comme causes réelles (« matérielles » en langage marxiste) de la situation [99].
C'est pourquoi nous allons aborder maintenant les caractères humanistes de notre science, notre art, notre éthique, en les envisageant pour eux-mêmes, sans tenter de les déduire de nos analyses précédentes, même si nous devions à chaque tournant les rencontrer.
Henri Van Lier
Le nouvel
âge, Ed. Casterman, Paris, 1962
[2] Cf. A. LBROI-OOTOHAN, Le gâte et la Parole, I. Technique et Langage, Albin Michel, 1964.
[3] L'esclavage est un résultat de la pauvreté technique mais en même temps la favorise : grossier, l'esclave n'améliore pas la machine, bien plus il est souvent incapable de l'entretenir. Cf. Friedrich KLBMH, Technik, eine Geschichtle ihrer Problème, 1954, où l'on trouvera, illustrée par la gravure et la citation d'époque, la matière du présent alinéa et du suivant.
[4] Dès l'Odyssée, méchanaomai veut dire tramer, surtout en mauvaise part. Songeons à notre « machiner ».
[5] Machinisme et Philosophie, 2e éd., P.U.F., 1947.
[6] Mumford a bien souligné que le verre contribua également à l'avènement de l'esprit occidental en favorisant l'observation impassible, objective, aussi bien des astres, jusque-là sacrés, que du monde sublunaire (in vitro), et en permettant à l'homme de s'apercevoir lui-même dans les miroirs qu'il perfectionne du XIIIe au XVIIe siècle, avec les conséquences réflexives et autobiographiques que l'on sait. Le papier, lui, permit le livre de compte, support du capitalisme. Op. cit., pp. 118-122, 129.
[7] Elle est certainement attestée à la fin du XIIe siècle, mais quelques auteurs la font remonter jusqu'à l'an mil, ce qui, en la rattachant à la fondation de l'Empire germanique et du royaume capétien, à la réforme de Cluny et aux premières basiliques romanes, à la révolution musicale de Guy d'Arezzo (cf. Jacques CHAILLEY, Histoire musicale du Moyen Age), ferait des origines de la civilisation « faustienne » un phénomène d'ensemble, très - presque trop - satisfaisant pour l'esprit.
[8] Ernst JÜNGER, Traité du Sablier, 1954 (trad. par H. Plard, Monaco, 1967).
[9] Sur le contenu de cet alinéa, cf. Wiener, Cybernétique et Société, 1949 (trad. 1952), pp. 208-210.
[10] Directement dans les machines simples (levier, poulie, treuil, plan incliné) indirectement dans les machines composées (tour, métier à tisser).
[11] Le mépris de la technique est inspiré, chez les Anciens, par des préjugés de castes sociales et surtout par les flétrissures des philosophes convaincus de la supériorité de l'intelligible sur le sensible (Platon, Gorgiaa et Lois ; Plutarque, Arcbiméde ; Sénèque, Ad Lucilium ; saint Thomas, Summa theologica). Pareil jugement poursuivra les artisans et les artistes jusqu'à la Renaissance, comme en témoignent les efforts de Vinci pour le réfuter. On le retrouve encore à l'article « Mécanique » du Dictionnaire français de Richelet (1680) : « Ce mot signifie ce qui est opposé à libéral et honorable... Le sens en est bas, vilain et peu digne d'une personne honnête et libérale. » - Mais tout cela, c'est la théorie. Sinon, Ulysse se vante d'avoir fabriqué son lit nuptial ; Socrate avait des prédilections de philosophe pour les manuels ; et c'est également un intérêt non seulement pratique mais théorique que nous trouvons dans les Diversarum artium schedulae du moine Théophile (XIe s.), dans le Didascalicon d'Hugues de Saint-Victor, dans les écrits de Robert Grosseteste, de Roger Bacon, de Pierre de Maricourt (XIIIe s.) ; De ce point de vue, l'aristotélisme thomiste marque un recul, il faudra attendre la fin de l'ère éotechnique, le XVIIe siècle de Fr. Bacon, Descartes, Leibniz, et surtout le XVIIIe siècle de l'Encyclopédie, pour que l'artisan soit pleinement apprécié.
[12] Les légendes primitives sont peu tendres pour ce dernier : si le Grec Vulcain boite, le Germain Wieland est perclus, le Juil Tubalcaïn descend de Caïn, et l'on sait les mésaventures de Prométhée, en rapport lointain avec le métier. Chez le primitif, le forgeron est d'habitude sorcier. - II s'agit donc moins là d'un jugement défavorable sur la technique en général que sur les arts de la forge, suspects aux peuples pasteurs, agriculteurs, marins, et mystérieux du seul fait qu'ils en appelaient à un élément fortement sacralisé, le feu.
[13] Sur ces tares, cf. MUMFORD, op. cit.., qui pour la dernière renvoie en particulier à Werner SOMBART, Luxus und Kapitalismus, Munich, 1913.
[14] L'Encyclopédie et le Progrès des sciences et des techniques, Centre international de synthèse, P.U.F., 1952.
[15] Plus précisément, la thèse de Nef s'appuie sur la différence de dates qu'il relevé entre l'Angleterre, vivant a l'abri de la guerre, et où l'essor commence vers 1785, et les pays les plus avancés d'Europe, théâtres des opérations militaires, où le mouvement ne s'amorce vraiment qu'en 1815. En tout cas, l'auteur s'insurge contre la date de 1760 proposée par Toynbee l'ancien. CL La Route de la guerre totale, Paris, 1949.
[16] Cf. Paul MANTOUX, La Révolution industrielle au XVIIIe siècle, Paris, 1905 (réédition, Génin, 1958).
[17] Voir les textes dans Fr. KLEMM, op. cit., pp. 188-195 et 253-257 ; ou, plus généralement, Max WEBBR, Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
[18] En réalité les choses furent plus complexes. Dans sa machine de 1690, Papin employait un piston mais ne prévoyait pas de séparation entre chaudière et cylindre. Dans sa pompe à vapeur de 1698, Savery envisagea et réalisa cette séparation mais en abandonnant le piston. Dans sa pompe à vapeur de 1706, Papin, mis au courant de l'Invention de Savery, utilisa la séparation mais rétrograda en remplaçant le piston de sa première machine par un simple flotteur de séparation entre la vapeur et l'eau pompée. Vers 1710, Newcomen conçut alors une pompe à vapeur avec séparation et avec piston ; mais elle était encore à simple action (le piston une fois élevé était ramené vers le bas par la pression atmosphérique qui s'exerçait sur sa face supérieure) et le cylindre y servait à la fois à l'expansion et à la condensation de la vapeur, avec les pertes d'énergies considérables d'un chaud et froid dans le même lien.
En 1763, Watt, réparant une Newcomen à Glasgow, se proposa de remédier à ce gaspillage en maintenant le cylindre constamment à la même température que la vapeur. Pour cela il l'entoura d'une steam-jacket, mais surtout il décida que la condensation de la vapeur se ferait dans un récipient séparé du cylindre, le condenseur. Cette machine était encore à simple action. En 1782 enfin, il faisait breveter une machine à double action, appliquant la vapeur et le vide des deux côtés du piston ; d'autre part, il stoppait la vapeur avant la fin de la course par une throttle-valve, le reste de la poussée étant obtenu par l'expansion. L'année précédente, il avait inventé un système (le sun-and-planet motion) pour transformer le mouvement alternatif du piston en mouvement rotatif d'un arbre pouvant actionner plusieurs machines.
Watt ne construisit pas d'engins à haute pression. Il ne construisit pas non plus les machines sans condenseur (avec échappement à l'air libre) qu'il annonça dès 1769, et qui supposent précisément de hautes pressions. Mais la chose était si bien dans l'esprit de ses découvertes, et elle allait si tôt en découler, qu'on s'est demandé si, très susceptible, il n'y avait pas renoncé parce que le principe était déjà contenu dans le Theatrum Machinarum (1725) de Jacob Leupold, de manière purement théorique il est vrai. Papin avait déjà fait remarquer à Leibniz que « l'action de la pression n'est pas limitée comme celle de la succion », mais dans le cadre très étroit de sa première machine.
[19] Nous n'ignorons pas que l'abandon du spectacle tient à une évolution interne de la peinture occidentale amorcée dès la Renaissance, et qui tendait à une peinture pure. Mais cette évolution elle-même s'explique, entre autres causes, par la désacralisation des apparences favorisée par la décadence de l'artisanat. - Ainsi, dans ses Entretiens recueillis par Charbonnier (Pion, 1961), Claude Lévi-Strauss définit l'impressionnisme comme un effort pour « exploiter de façon plus intensive... le domaine amoindri qui restait disponible » et pour « apprendre aux hommes à se contenter de la menue monnaie d'une nature à jamais disparue pour eux » (cité par Jean Piel, « Critique », no 167).
[20] Sur les rapports de l'esthétique et de la machine au XIXe siècle, cf. Pierre FRANCASTEL, Art et technique, 1956.
[21] Cf. MUMFORD, Technique et civilisation, 1934 (trad., 1950), pp. 141-193. Sur l'école anglaise, encore au début de ce siècle, qu'on voie les souvenirs d'enfance de Graham Greene.
[22] Cf. Fr. SCHNABEL, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Freiburg i. Br., 1930, vol. III : Erfahrungswissenschaften und Technik. - II ne faudrait pas oublier cependant que l'Angleterre fit un effort très moderne pour panser ses plaies en créant des commissions non seulement économiques mais sanitaires (Public Health), d'une grande impartialité.
[23] La machine à vapeur fut doublement centralisatrice : parce qu'elle avait d'autant plus de rendement qu'elle était plus grosse, et que, comme toutes les sources d'énergie qui l'avaient précédée, - humaine, animale, hydraulique, éolienne, - elle utilisait un système de transmission mécanique, où le moindre éloignement spatial entraînait des pertes énormes.
[24] On trouve cependant dans les Problèmes mécaniques (ch. l) du Pseudo-Aristote : « Est extraordinaire ce qui s'accomplit naturellement mais sans que nous en sachions les causes ; de même, ce qui se fait contre la nature, par art, en vue des besoins humains : en bien des choses la nature travaille au rebours des besoins de l'homme, car elle a ses voies propres ». Mais le contre dont il s'agit ici, et qui est traditionnel dans la philosophie grecque, est bien innocent : il ne s'agit nullement de défigurer la nature mais, par « les modification » imperceptibles, de l'harmoniser avec les besoins humains.
[25] Cf. Friedrich DESSAUER, Streit um die Technik, Herder, 1959.
[26] Friedrich DESSAUER, qui insiste sur la carence doctrinale des techniciens, l'attribue à l'antériorité, en tous domaines, des problèmes particuliers sur les problèmes généraux. L'explication nous parait trop courte.
[27] Ces phénomènes tiennent autant à un état clé de la machine qu'à une déviation politique de Staline lui-même. Ils montrent en tout cas l'insuffisance du slogan de Lénine : « Socialisme + électrification = communisme. »
[28] Le cénacle de Columbia University, où domina bientôt la personnalité de l'économiste et théoricien de la machine Thornstein Veblen, fut un peu à la machine dynamique ce qu'avait été l'Encyclopédie pour la machine statique : à coup de surveys, il explicite l'énergétisme, il le rationalise, mais en même temps il le conclut et annonce un âge nouveau.
[29] Si on mettait en doute les transformations que comporte la suppression de la rareté, ou plus radicalement la possibilité d'une société où la rareté ne commanderait plus, qu'on lise l'intéressant article (Diogène n° 20) où Georges Dumézil commente le sermon sur les inconvénients de la richesse (Pâques 1646) du Père Francesco Davila à des Incas dont la langue, conçue dans un régime d'abondance et d'entraide, n'avait pu de mot pour distinguer un riche.
[30] Les Allemands distinguent Antreibsmaschinen (Kraftmaschinen) et qualitätschaffende Maschinen ; « modèlement » nous semble moins ambigu que « qualité ».
[31] Cf. G. ANDERS, Die Antiquiertheit des Menschen : Die Welt als Phantom und Matrize, Munich, 1956.
[32] D'autres parleront de rationalisation (Lilje), d'objectivation (Simmel), ce qui nous paraît plus équivoque.
[33] Ce dernier thème a été développé par JASPERS, La situation spirituelle de notre époque, 1930 (trad. 1951).
[34] Rappelons en vrac quelques noms : Ortegat y Gasset, Duhamel, A. Huxley, Spengler, F.-G. Jünger, Rustow, Gabriel Marcel, Thibon, De Corte...
[35] L'énergie atomique, centralisatrice dans ses modes de production, exigeant de considérables rassemblements d'hommes et de matériaux, est décentralisatrice dans ses modes d'utilisation, où son faible volume, aisément transportable, la rend indépendante du site minier.
[36] Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958.
[37] On se souviendra qu'il avait pour objet de se rapprocher du cycle idéal de toute machine thermique défini par Carnot dans ses Réflexions sur la puissance du feu (1824), ouvrage de pure théorie.
[38] Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948 (2° éd., New York, 1961).
[39] Cf. Gilbert SIMONDON, op. cit., p. 22.
[40] Cf. Ken W. PURDY, An Entirely New Engine, The Atlantic Monthly, juillet 1960.
[41] SIMONDON, op. cit., 28-46.
[42] Celle de l'huile sous pression, par exemple, dont Simondon souligne qu'à la fois elle lubrifie la génératrice, isole l'enroulement, conduit la chaleur de l'enroulement au carter, s'oppose à l'entrée de l'eau dans ce dernier à travers les presse-étoupes de l'axe, puisque sa pression est supérieure à celle de l'eau à l'extérieur. Op. cit., p. 54.
[43] SIMONDON, op. cit., p. 55-56.
[44] Nous parlons ici de l'aristotélisme vulgaire, qui seul a influencé la vision de la machine ancienne, et qu'Aristote d'ailleurs est souvent loin d'éviter dans ses façons de parler. Pour ce qu'il y a de plus subtil dans sa théorie, cf. DUBARLE, La causalité dans la philosophie d'Aristote, in Histoire de la philosophie et métaphysique, Desclée De Brouwer, 1955. La distinction entre matière et forme est encore sensible dans cette définition kantienne de la machine : « ein Körper, dessen bewegende Kraft von seiner Figur abhängt », Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786. Cuvier disait de même que les machines sont de la géométrie vivifiée.
[45] Cette dernière affirmation vaut plutôt en droit qu'en fait. Aussi longtemps que nous ne disposerons pas d'un moteur atomique, nous ne pourrons convertir l'énergie nucléaire en énergie cinétique (machinique) qu'en passant par le détour de l'énergie calorique, ce qui comporte une grande perte de rendement : même en une époque de concrétude, une technique nouvelle connaît d'abord un stade abstrait. Néanmoins des schèmes synergiques interviennent déjà soit dans le surchauffage améliorant le cycle de la vapeur, soit dans l'autorégénération améliorant le cycle du combustible.
[46] Ceci n'est évidemment pas applicable à certains moteurs lents, tels les Diesel lourds d'usine, spécialement conçus pour brûler des huiles très diverses et très peu raffinées. Mais on pourrait montrer comment, même dans ce cas, la matière du combustible et la structure machinique sont de plus en plus intimement liées.
[47] Comme l'ont noté tous les bons observateurs de la machine, l'homme technicien n'est pas uniquement préoccupé de rendement. Il est très sensible au caractère des objets qu'il construit. Il y a un style de la machine. Cf. Manfred SCHRÖTER, Philosophie der Technik, Munich, 1934.
[48] Somme toute, les calculatrices peuvent être ou analogiques ou logiques (numériques, digitales), et exploiter la connexion spatiale d'autant d'organes qu'il y a d'opérations ou la connexion séquentielle de quelques organes selon un programme. Ce qui donne quatre grands types, dont les plus usités sont les machines analogiques calculant analogiquement par connexion spatiale, et les machines logiques ou ordinateurs calculant numériquement (digitalement) par connexion séquentielle programmée. Cf. John VON NEUMANN, The Computer and thé Brain, Yale University Press, New Haven, 1958.
[49] Par un fil métallique relié à l'aimant mobile et plongeant, selon les besoins, dans un bac conducteur à gradient de potentiel. Cf. W. R. ASHBY, Design for a brain, Chapman and Hall, 1952.
[50] C'est parce qu'il a été frappé surtout par les machines de contrôle (governor = régulateur), et que celles-ci reposent avant tout sur des transferts d'informations, que Wiener a donné le nom de cybernétique (kubernètès = pilote) à la théorie de l'information en général. Le titre de son premier ouvrage est explicite à cet égard : Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine.
[51] On se montre actuellement sévère pour les jouets de l'auteur de The living Brain. Par exemple, Silvio CECCATO, Cybernétique, « Diogène » n° 53.
[52] On trouvera une critique pertinente des assimilations hâtives faites par les cybernéticiens entre machines et vivants dans R. RUYER, La Cybernétique et l'origine de l'information, Paris, 1954.
[53] Pour deux éléments, il y a déjà sept modes de comportement possibles : 1) A et B sont inactifs ; 2) A est actif sans que B le soit ; 3) B est actif sans que A le soit ; 4) A et B sont actifs ; 5) A entraîne B ; 6) B entraîne A ; 7) A et B s'entraînent réciproquement. Pour mille éléments cela donne environ 10.300.000 comportements possibles. Ceci, notons-le, ne permet pas de calculer le nombre de comportements possibles du cerveau humain avec ses milliards de cellules, car il faudrait savoir combien parmi celles-ci sont homologues, et si toutes les interconnexions sont possibles. Cf. GREY WALTER, op. cit., pp. 86-87.
[54] Le cerveau fonctionne avec un voltage et une dispersion spatiale très réduits, et cette double économie semble conditionner l'apparition de la vie et de la conscience. Pour s'en rapprocher, il faudrait dans nos engins cybernétiques remplacer les connexions grossières des lampes thermioniques par des connexions électrochimiques aussi élégantes que celles que rencontre le biologiste. Si nous y parvenions, nous aurions pénétré dans un nouvel âge technique, celui de la machine vivante. Bien que l'hypothèse ne semble plus pouvoir être exclue pour un avenir plus ou moins lointain, nous n'avons pas à nous y arrêter dans une étude de notre situation culturelle présente.
[55] Toute communication efficace d'une structure peut, semble-t-il, être appelée une information, et il n'est pas illégitime de dire que les variations de la pression barométrique « nforment » le baromètre enregistreur, ou que les ondes sonores, transmises électriquement par le téléphone ou la radio, « informent » les appareils récepteurs ou enregistreurs. Cette définition objective de l'information - qui se trouve d'ailleurs conforme au sens primitif du mot - aura en outre l'immense avantage de la rendre accessible à la mesure. Si l'information est essentiellement le progrès d'un ordre structurel efficace, elle sera le contraire d'une « déstructuration », d'une diminution d'ordre. Cette diminution d'ordre a un nom en physique : l'entropie. L'information pourra donc être considérée comme le contraire d'une entropie, et elle sera mesurable comme celle-ci. » Cf. Raymond RUYER, La Cybernétique et l'Origine de l'information, Paris, 1954, p. 9, qui montre du reste les dangers de cette définition physique d'un phénomène initialement psychologique.
[56] Rappelons-nous que le XIXe siècle ne conçut pas clairement l'originalité physique de l'ordre, qu'il considéra seulement en fonction de l'énergie. Le premier principe de la thermodynamique lui montrait qu'un moteur requiert une source froide et une source chaude, c'est-à-dire un certain arrangement des molécules rapides et des molécules lentes. Le second principe de la thermodynamique affirmait qu'un système isolé tend vers son état le plus probable, c'est-à-dire que la quantité de désordre, ou entropie, ne pouvait qu'y augmenter.
La théorie de l'information permet de voir que ce concept n'est pas nécessairement limité à l'énergétique, car il sert à mesurer la « quantité d'information » d'un message. Celle-ci est d'autant plus grande que le message est moins désordonné, moins « probable » ; elle croît en proportion arithmétique quand l'improbabilité croît en proportion géométrique ; elle est donc égale au logarithme de l'improbabilité ou, si l'on préfère, au logarithme négatif de la probabilité, - tout comme l'entropie d'un système est égale au logarithme positif de sa probabilité.
[57] Le désir de construire un être vivant, et surtout un homme, est attesté par les mythes anciens. Dans la légende allemande, saint Albert le Grand est moins un saint ou un savant que l'inventeur d'un Homoncule qui ouvrait sa porte, saluait et introduisait ses visiteurs, jusqu'au jour où saint Thomas d'Aquin, reçu chez son maître par cette créature sacrilège, l'aurait détruit à coups de bâton. Cf. DESSAUER, op. cit., p. 121.
[58] On se souviendra de l'apologue chestertonien de l'homme trouvant dans le désert une corde et un téléphone. Que peut-on faire avec un téléphone sinon téléphoner ? Il y a mille usages à une corde. « Pour déraciner un de ces ustensiles simples et vénérables, il faudrait arracher cent racines, et non pas une. Presque toutes ces vieilles institutions sont quadrupèdes - certaines centipèdes. »
[59] Le terme et le thème reviennent sans cesse chez Gilbert Simondon, op. cit.
[60] L'exemple de Huston pour les vols spatiaux est assez parlant.
[61] Il est instructif de suivre de ce point de vue l'évolution de l'organisation d'IBM.
[62] Sous cet angle, il n'y a guère de différence entre les Etats (ces entreprises géantes) et les entreprises géantes (ces états supranationaux), sinon que la mutation est moins facile pour les premiers.
[63] Cf. Paul FITTS, Engineering Psgchology and Equipment Design, in « Handbook of Experimental Psychology, edited by S. S. Stevens, Londres-New York, 1951.
[64] Cf. On trouve un écho de ces préoccupations nouvelles dans A. CHAPANIS, Research Techniques in Human Engineering, Baltimore, 1959 : « II y a deux siècles l'homme n'était qu'un système compliqué de leviers et de vaisseaux nerveux et sanguins. Il y a quinze ans ce n'était qu'un servo. Maintenant il n'est plus qu'un canal véhiculant des informations. Appelez-le une machine si vous voulez, mais ne le sous-estimez pas quand vous expérimentez sur lui. C'est une machine non linéaire ; une machine programmée avec un taping que vous ne connaissez pas ; une machine qui change sans cesse sa programmation sans vous en avertir ; une machine qui semble être particulièrement sujette aux bruits de fond ; une machine qui pense, qui a des attitudes et des émotions ; une machine qui peut s'efforcer de décevoir vos efforts pour découvrir son fonctionnement, - à quoi elle réussit parfois avec brio », pp. 15-16.
[65] Nous continuons à négliger l'hypothèse d'une machine vivante, qui nous semble ne pas concerner l'humanisme d'aujourd'hui. Cf. note 54.
[66] Cf. R. RUYER, op. cit. et Structures des automates et liberté, dans « Structures et Liberté », Paris, 1958, où l'on trouve des formules heureuses telles que celle-ci : « L'homme est un automate une fois qu'il s'est monté lui-même par un effort conscient, mais non en tant qu'il est en train de se monter. Quand je fais un calcul mental, je suis nécessairement à la fois machine et ingénieur. »
[67] Le rôle de l'interrogation est bien illustré par le va-et-vient des questions et des réponses entre la machine et l'opérateur au fichier électronique ; le rôle du projet apparaît au mieux dans la « recherche opérationnelle » où, en fonction des buts d'un état-major, toutes les formes d'exploration techniques de la situation sont mises en œuvre, laissant la décision au commandement.
[68] Sir George Thomson estime que nous n'avons pas tiré tout le parti possible de la domestication qui, depuis l'antiquité, n'a guère fait de progrès. La meilleure machine à cueillir les oranges est peut-être le singe. Cf. L'Avenir prévisible, Calmann-Lévy, 1958.
[69] L'invention vraie n'est pas un affinement, ni une adjonction ; elle comporte un saut d'une forme à une autre forme, où la situation nouvelle des éléments ne peut être conçue que le problème résolu. Cf. SIMONDON, op. cit., pp. 50 à 60.
[70] Sur le rendement, cf. MUMFORD, op. cit., 103 à 237.
[71] Cf., entre mille autres exemples, Colloque sur le projet d'un marché commun afro-asiatique publié dans « Correspondance d'Orient », n° 1, en particulier les communications des professeurs Berque et Cerulli, et de Henri Haustrate.
[72] Celle-ci va si loin que la contrainte et le don, facteurs négligeables dans l'économie du XIXe siècle, où l'homo aeconomicus se définissait par l'échange et la concurrence, prennent aujourd'hui une signification non seulement morale mais proprement économique. Cf. Fr. PERROUX, Economie et Société: Contrainte, Echange, Don, P.U.F., 1960.
[73] Il y a de nombreuses interprétations d'Héraclite, plus hasardeuses les unes que les autres, mais toutes retiennent l'obéissance des phénomènes à un Logos, si déroutant qu'on l'imagine.
[74] Cf. Georges LUKACS, La situation présente du réalisme critique, qui oppose pertinemment naturalisme et réalisme, 1957 (trad. N.R.F., 1960).
[75] Ce principe n'est jamais clairement dégagé mais il est partout sous-jacent dans L'Avenir prévisible de George Thomson (1955, trad. de l'anglais chez Calmann-Lévy, 1958), où l'on retrouvera de plus amples développements sur les exemples ici allégués de la pluie, de la Chlorella et du Kryllium.
[76] Il est suggestif de comparer la différence de mentalité qui sépare deux déclarations de savants pourtant presque également scientistes : « Un jour viendra où chacun emportera pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite motte de matière grasse, son petit morceau de fécule ou de sucre, un petit flacon d'épices aromatiques, accommodées à son goût personnel : tout cela fabriqué économiquement et en quantités inépuisables par nos usines ». (BERTHELOT, Science et Morale, Calmann-Lévy, 1897), et celle-ci : « Si le goût des champignons persiste - et il persistera sûrement - il sera probablement toujours plus facile de les faire pousser que de les fabriquer » (THOMSON, op. cit., 1955).
[77] Friedrich DESSAUER, Streit tun die Technik, Kurzauffassung, Herder, 1959, qui contient l'essentiel de sa Philosophie der Technik de 1934.
[78] Le mot « technique » a donc exprimé bien des réalités différentes an cours des âges : 1° La technè de Socrate et Platon désigne une propriété non des objets mais de l'homme qui possède une vertu opérative : elle appartient au monde de la machine statique où l'ouvrier reste l'essentiel et n'est que prolongé par l'instrument. 2° Puis le mot se met à qualifier les engins (spatiaux) et les procédés (temporels) à mesure qu’ils deviennent autonomes et remplacent l'homme : mais les objets, les actions, les problèmes et les solutions ainsi qualifiés restent individuels, ne forment pas encore un domaine. 3° La technique, depuis la fin du XIXe siècle, désigne de plus en plus souvent le domaine des objets et procédés techniques envisagés comme totalité : dès 1877, les Grundlinien einer Philosophie der Technik de Ernst Kapp emploient le mot dans ce sens. (Sur ces trois premières acceptions, cf. DESSAUER, op. cit.). 4° Actuellement, l'adjectif peut qualifier notre monde en général, la technique cessant d'être un royaume dans notre univers pour devenir une dimension, une propriété essentielle de l'univers lui-même.
[79] Qu'on songe au « milieu technique » décrit par Georges Friedmann.
[80] Nous prenons ici le mot dans son extension religieuse et profane : il couvre alors tout rite collectif où un humanisme s'exprime et se fonde.
[81] Comme Aristote après Platon y insiste dans sa théorie de la forme, principe de perfection, s'imprimant dans une matière, principe d'imperfection et de multiplication numérique. Dante dit encore : perch' a risponder la materia è sorda (Par. I, 129).
[82] Cf. WIENER, Cybernétique et Société, 1949 (trad. Deux Rives, 1952), pp. 153-154; 163-164; 219.
[83] Qu'on se reporte au schéma du tout récent moteur Wankel, supra p. 41.
[84] Le français manque d'un mot pour exprimer l'acte technique que les Allemands rendent par Gestaltung : « formation », « conformation », « configuration » marquent plutôt le résultat que l'acte; « arrangement » et « disposition » donnent trop à croire qu'il s'agit d'éléments préalablement définis et qu'il suffirait de combiner ; « mise en forme » suggère l'impression dans une matière d'une idée conçue d'avance. Reste « acte de configuration ». On se demandera si ce défaut de vocabulaire est à l'origine de l'équivoque française sur la technique science appliquée, ou au contraire si l'équivoque explique la carence verbale.
[85] Nous préférons « instauration » à « création » parce que le mot marque bien qu'il s'agit de la production d'un nouvel être (étienne Souriau), mais en même temps que cette nouveauté est le fait non d'un démiurge mais d'un être-ouvrier.
[86] Ce vocabulaire est malheureux. Il donne à croire que l'artiste est désintéressé, alors qu'il peut être âpre au gain (Rubens), et que le technicien est intéressé, alors qu'aussi souvent que l'artiste il agit sans intérêt. Au lieu de distinguer « intéressé » et « désintéressé », nous devrions pouvoir, comme l'allemand, distinguer « avec finalité » (mit Zweck) et « sans finalité » (ohne Zweck). En effet, Kant oppose clairement Ziel, le but humain poursuivi par l'homme et qui, en technique comme en art, peut n'avoir aucun rapport avec l'œuvre (gloire, gain, prosélytisme), et Zweck, finalité instrumentale dont l'œuvre est le moyen, et que seul possède l'objet technique (et un art comme l'architecture en tant qu'il est technique). Il faudrait donc dire que, par opposition à l'artiste, configurateur sans finalité instrumentale, le technicien est un configurateur instrumental. Ce qui donne mieux à voir que son activité ne procède pas nécessairement de besoins économiques ou de besoins vitaux et peut parfois, même souvent, provenir du seul désir, spécifiquement humain, d'introduire l'ordre là où il est absent.
[87] Günther Anders a soutenu que l'homme d'aujourd'hui éprouverait une sorte de honte devant la machine, une honte de Prométhée (prometheische Scham) devant sa créature plus parfaite ; honte de son corps, de sa chair, honte d'être né et non pas fabriqué. Sans doute avons-nous commencé à transformer notre anatomie et notre physiologie (qu'on songe aux fortifiants, excitants, tranquillisants, contraceptifs, ainsi qu'aux greffes de tous genres), et notre organisme est donc aussi devenu une nature artificielle ; mais ces perfectionnements sont peu de chose en comparaison des brillants progrès de la machine ; en sorte que c'est actuellement notre corps périmé (antiquiert) qui fait obstacle aux vols spatiaux (d'où la nécessité d'un Training), c'est la lenteur de notre cerveau qui empêche de tirer tout le profit des calculatrices électroniques, etc. De là, remarque Anders, le besoin qu'ont nos contemporains les plus industrialisés, de se mettre au diapason de la machine : témoin le make up qui, en certains pays, s'étend des ongles au sourire (Cf. Die Antiquiertheit des Menschen, Munich, 1958).
Et peut-être y a-t-il de cela dans les sociétés très mécanisées, surtout celles qui sont passées à l'industrialisation sans avoir connu une cohérente et profonde culture préalable, comme l'Amérique et la Scandinavie. Mais il ne faudrait pas en conclure que nous ayons honte de nous-mêmes et que nous ayons renoncé à la prétention de Protagoras d'être la mesure de toutes choses. Car l'homme est autant ses produits et ses projets que son corps et son cerveau, surtout lorsque ses produits et ses projets deviennent son corps et son cerveau prolongés. Et, en effet, la crainte révérentielle devant la machine, naguère encore morceau de choix des essayistes, semble en voie de disparition.
[88] Bertrand RUSSELL, Science, puissance, violence, Bruxelles, 1954.
[89] C'est assurément pour désigner cette structure plurinodale que se multiplient actuellement des termes comme polyarchie (Dahl et Lindblom), polyhiérarchie (Louis Armand), polysynodie (Michel Massenet), etc.
[90] Cf. Isaac DEUTSCHER, La Russie après Staline, Le Seuil, 1953.
[91] Bien plus, la notion d'élite, et conséquemment celle de « promotion sociale », sont périmées : notre société interdépendante n'a rien de commun avec les sociétés coniques d'autrefois, où il fallait nécessairement qu'on monte ou qu'on descende, que la base obéisse à la pointe ou la pointe à la base. A y réfléchir, le carriérisme et le talentisme sont des séquelles attardées de l'ère dynamiste. Cf. G. COHEN-SÉAT et P. FOUOEYROLIAS, L'action sur l'homme : Cinéma et télévision, Paris, Denoël 1961, où les auteurs attribuent à l'image filmique ce qui nous parait résulter des structures générales du monde contemporain.
[92] On connaît assez l'embourgeoisement de l'ouvrier qui fait le désespoir des militants syndicaux, et en retour la démocratisation des bourgeois dans le vêtement, le plaisir, la morale : les deux mouvements étant commandés par la participation au même monde technique. Plus importante peut-être du point de vue humaniste (liturgique, poétique, artistique) est la disparition de la division entre la ville et la campagne, celle-ci étant assimilée à celle-là par les moyens de diffusion et de communication, mais davantage encore par l'exploitation du sol d'après des procédés qui transforment le champ en usine et le paysan en ingénieur. Enfin le sentiment d'égalité dont ne doutent plus les colonisés à l'égard de leurs colonisateurs d'hier tient lui aussi au fait que l'objet technique confère la puissance à quiconque en a assimilé (ou sait qu'il pourra en assimiler) le maniement.
[93] Cf. Pierre URI, Dialogue des continents, Pion, 1963.
[94] New York, 1956 (trad. de l'américain, Pion, 1959), surtout dans les chapitres consacrés à Park Forest, banlieue de Chicago.
[95] Cette notion essentielle qu'on retrouve un peu partout dans les sciences de l'homme actuellement est bien illustrée dans MASLOW, Motivation and Personality, New York, 1954 ; inspirée de Bergson mais profondément transformée, elle soutient, depuis plus de trente ans, la recherche de J.-L. Moreno. Cf. Fondements de la sociométrie, P. U. F., 1954.
[96] Aussi la Bell Téléphone compte environ 300 ingénieurs chargés d'imaginer la situation dans dix ou vingt ans, et on sait que le Centre International de Prospective a pour objet « l'étude des causes techniques, scientifiques, économiques et sociales qui accélèrent l'évolution du monde moderne, et la prévision des situations qui pourraient découler de leurs influences conjuguées ».
[97] Cf. par exemple J. FOURASTIÉ, La Prévision de l'évolution économique contemporaine, Diogène n° 5 et la plupart des autres ouvrages de l'auteur.
[98] Der Mann auf der Brücke, Tagebuch aus Hiroshima und Nagasaki, Munich, 1959, auquel nous empruntons la substance de cet alinéa et du suivant.
[99] Cf. André GORZ, La Morale de l'Histoire, Le Seuil, 1959.